CAMPS DE CONCENTRATION, CAMPS D' EXTERMINATION
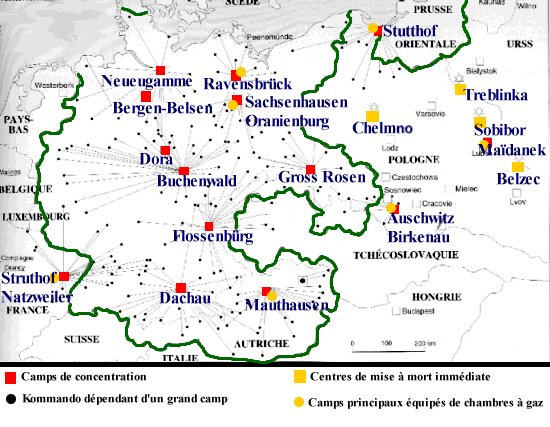
Pour bien comprendre le régime nazi et son fonctionnement et pour éviter les confusions, il importe de distinguer camps de concentration et camps d'extermination.
1) Les camps de concentration, organisés sur le territoire allemand depuis 1933 et où ont d'abord été enfermés des Allemands antinazis, ainsi que des Juifs et des prisonniers de droit commun, étaient destinés à interner -provisoirement ou définitivement- des individus jugés dangereux par mesure de sécurité, par mesure préventive ou par mesure de rééducation. Entre 1939 et 1945 le nombre des détenus s'est considérablement accru : on y trouvait pêle-mêle déportés politiques, prisonniers de droit commun, homosexuels, témoins de Jéhovah, etc. Ces camps, auxquels les terribles conditions d'existence ont valu le nom de camps de la morte lente, étaient au nombre d'une douzaine : Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mauthausen - Gusen, Stutthof, Neuengamme, Dora - Nordhausen, Flossenburg, Gross - Rosen, Theresienstadt, Bergen - Belsen, Natzweiler-Struthof.
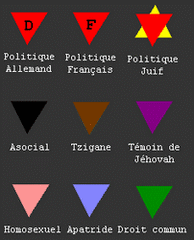
Dans les camps de concentration, comme il y avait plusieurs catégories de détenus -même si tous étaient soumis au même régime- on reconnaissait la catégorie du détenu à la couleur du triangle cousu sur son vêtement : triangle rouge pour les politiques (c'est-à-dire avant 1939 les opposants allemands au nazisme, principalement les communistes, puis les résistants de toute l'Europe), triangle vert pour les droit commun, triangle rose pour les homosexuels, triangle violet pour les témoins de Jéhovah, triangle noir pour les asociaux (selon une définition très vague, était classé comme asocial tout individu manifestant par son comportement qu'il ne veut pas s'intégrer dans la communauté).
Par une ordonnance du 7 décembre 1941 a été créé le système NN, Natcht und Nebel (Nuit et Brouillard) pour certains résistants transférés sans jugement en Allemagne et destinés à disparaître sans laisser de traces.
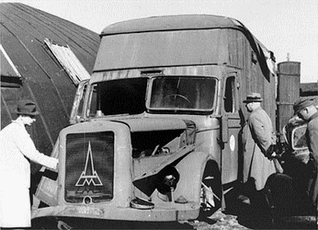
Les camions à gaz utilisés à Chelmno
Sur le plan statistique, s'il est difficile de dénombrer exactement les effectifs des camps de concentration, d'autant que les archives de quelques-uns d'entre eux ont été détruites, on estime qu'entre septembre 1939 et janvier 1945 1 650 000 personnes (pour la plupart hommes, mais ce chiffre comprend aussi des femmes et des adolescents) y ont été déportées.(1)
Sur ce total, au minimum 550 000 détenus sont morts, soit le tiers environ .Toutefois le taux de mortalité varié en fonction des catégories de déportés : plus élevé chez les politiques, c'est-à-dire chez les résistants, il a atteint 60 % dans le cas des homosexuels (ceux-ci, qualifiés de délinquants sexuels et coupables de porter atteinte moralement, physiquement et matériellement au peuple allemand étaient depuis 1935 passibles de dix ans de travaux forcés et dans certains cas d'internement à vie).

2) Les camps d'extermination, au nombre de six et tous situés sur le territoire de la Pologne de 1939, ont fonctionné de 1941 à 1944. C'étaient des établissements sui generis, indépendants des camps précédents, et dont la fonction était d'éliminer physiquement le plus grand nombre possible d'êtres humains de la façon la plus rapide et avec le rendement maximum. Quatre d'entre eux étaient uniquement des camps d'extermination : Chelmno (Kulmhof), Belzec, Sobibor et Treblinka ( on peut dans ce cas à peine parler de camps : c'étaient des terminus ferroviaires où, dès leur arrivée, les déportés étaient conduits directement aux camions à gaz ou aux chambres à gaz pour être tués). Deux autres camps, Auschwitz -Birkenau et Lublin - Maïdanek, ont été des camps mixtes : d'abord camps de concentration, puis aménagés pour une large part en installations d'extermination avec chambres à gaz et crématoires.
Deux précisions complémentaires sont à apporter :
1° Dans certains camps de concentration ont été pratiqués des gazages ponctuels, par exemple à Mauthausen, Stutthof, Natzeiller-Struthof, etc. (En revanche les gazages massifs n'ont eu lieu que dans les camps d'extermination).
2° En 1944-1945, au moment de la défaite allemande, un certain nombre de détenus des camps d'extermination ont été évacués et regroupés dans les camps de concentration situés sur le territoire du Reich (par exemple Bergen-Belsen, Mauthausen, etc) : c'est là que les survivants ont été libérés par les Alliés.
Enfin dans la machine concentrationnaire une distinction essentielle doit être soulignée : celle qui exister d'après la Weltanschang nationale-socialiste entre répression et extermination. D'où la ligne qui sépare les Juifs, les Tziganes, les malades mentaux, les Slaves, groupes voués à l'extermination (même s'il y eut des degrés dans le génocide, puisque les Juifs en ont été les victimes principales, de loin les plus nombreuses, tandis que dans les cas des populations slaves il y eut simplement un début de réalisation), d'autre part les déportés résistants, les témoins de Jéhovah, les homosexuels.
Les premiers sont nés juifs, tziganes, etc. Aucun n'a choisi d'appartenir à ce groupe ethnique. Tous ont été assassinés en tant que tels, indépendamment de leurs actes : hommes, femmes, enfants, vieillards. Quant aux aliénés et aux incurables, victimes de la maladie, leur mise à mort relève du même mécanisme racial.
Dans le cas des détenus des camps de concentration, ils ont été persécutés de la manière la plus barbare, subissant les mauvais traitements, la faim, le froid, les épidémies, le travail forcé, les brimades, les punitions, les brutalités, le mépris quotidien. Toutefois la répression sauvage, parfois sadique, dont ils étaient victimes n'était pas motivée par ce qu'ils étaient mais bien plutôt par ce qu'ils avaient fait. Si un grand nombre d'entre eux sont morts, et dans des conditions atroces, ils n'ont pas fait l'objet d'une mise à mort systématique et industrielle, comme ce fut le cas avec les usines de mort qu'étaient les chambres à gaz pour les victimes de l'extermination.
(1) Cette statistique ne comprend donc pas les déportés raciaux envoyés dans les camps d'extermination.
Source : Le génocide et le nazisme. François Bédarida. Presses.Pocket.
LES USINES DE LA MORT

Fours crématoires à Majdanek, le 23 juillet 1944
Les camps de concentration sont des camps d'emprisonnement et de travail forcé pour les adversaires politiques du nazisme (communistes, syndicalistes, résistants) et pour les asociaux (criminels de droit commun, témoins de Jéhovah, homosexuels...). Les traitements infligés aux détenus sont très durs et les conduisent souvent rapidement à la mort. Dans certains camps de concentration, il y a des chambres à gaz, mais pas dans tous. Elles sont généralement de petite capacité.
Les camps d'extermination sont destinés à détruire méthodiquement, industriellement les vies humaines, en particulier par des chambres à gaz de grande capacité. Ces camps n'emploient que peu de main d'oeuvre, juste ce qu'il faut pour récupérer les affaires des déportés exterminés et détruire les corps dans les fours crématoires.
Le camp d'Auschwitz est un cas particulier, à la fois immense camp de concentration et camp d'extermination (à Birkenau).
Buchenwald
Construit au départ pour être un camp de criminels et de prisonniers politiques. Buchenwald commença à fonctionner le 19 juillet 1937. Situé sur le versant nord de l'Ettersberg, environ cinq kilomètres au nord de Weimar, c'était en fait une constellation de 130 camps, l'un des ensembles concentrationnaires les plus importants du territoire allemand. Le camp principal était divisé en trois parties : le grand camp, dont les détenus étaient séparés des autres ; et le camp sous bâche, qui accueillit d'abord les prisonniers polonais après l'invasion de la Pologne en septembre 1939.
Les prisonniers juifs commencèrent à arriver à Buchenwald avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de l'été 1938, 2 200 Juifs autrichiens furent transférés de Dachau à Buchenwald ; après la nuit de Cristal (9-10 novembre 1938), plus de 10 000 Juifs y furent consignés. Comme ailleurs, ils furent traités avec plus de brutalité que les autres détenus, à l'exception des soviétiques, qui étaient presque toujours éliminés dès leur arrivée.
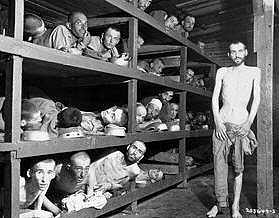
Le camp ne connut que deux commandants : Karl Koch (1937-1942) et Herman Pfister (1942-1945). En 1944, la population du camp atteignait presque 90 000 prisonniers. Entre 1937 et 1945, plus de 238 000 prisonniers en provenance de plus de 30 pays passèrent par Buchenwald ; plus de 55 000 furent tués ou moururent. Une certaine résistance s'organisa dès le début qui se manifesta par de petits actes de sabotage et l'introduction clandestine d'armes et de munition.
Deux ans après la libération du camp, seuls six membres de l'administration du camp furent jugés ; deux d'entre eux furent exécutés, et quatre condamnés à la prison à perpétuité.
Dachau

Le camp de Dachau fait exception puisqu'il sera le seul de ces camps à rester utilisé jusqu'à la fin de la guerre et servira de prototype à tous les camps de concentration ultérieurs.
Dachau fut le premier de tous les camps de concentration ou de la mort créés par les nazis, puisqu'il fonctionna de mars 1933 à avril 1945. Situé à une quinzaine de kilomètres de Munich, en Bavière, il vit passer plus de 200 000 détenus, qui franchissaient les clôtures électrifiées, sous le panneau de bienvenue Arbeit macht frei (le travail rend libre), affiché à l'entrée de nombreux camps. On estime que plus de 70 000 prisonniers, en majorité juifs, moururent à Dachau, même s'il est impossible de donner un nombre exact ; environ 30% de ceux qui étaient encore en vie au moment de la libération du camp étaient juifs.
Site d'une industrie d'armements de la Première Guerre mondiale, Dachau fut au départ un camp d'internement pour les prisonniers politiques : communistes, sociaux-démocrates et autres opposants du régime nazi, dont les Juifs.

Corps
suppliciés dans le camp de Dachau nouvellement libéré.
(fin avril début mai 1945)
Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, Dachau continua de recevoir des opposants, ainsi qu'un nombre croissant de Juifs : ils furent plus de 10 000 à y être envoyés après la nuit de Cristal (9-10 novembre 1938). Seuls ceux qui pouvaient prouver qu'ils allaient quitter le pays furent libérés.
Le premier commandant de Dachau fut Theodore Eicke, qui allait devenir inspecteur général de l'ensemble concentrationnaire nazi. Dès juin 1933, il établit un règlement qui comprenait l'électrification des clôtures et l'exécution immédiate de tous ceux qui s'approchaient de l'enceinte du camp ; il imposa par la suite des règlements de ce type à l'ensemble des camps.

Expériences extrêmes réalisées par des médecins nazis sur des prisonniers
C'est à Dachau que furent menées les premières expériences médicales sur des détenus. Les plus connues furent des expériences en haute altitude, des essais d'immersion profonde en eau de mer, conçus pour la Lufwaffe, des inoculations de la malaria, des vaccins expérimentaux. On estime que presque 400 prisonniers furent soumis à de telles expériences, et d'un quart d'entre eux environ y succombèrent.
Pendant la guerre, des prisonniers en provenance des différents pays occupés par l'Allemagne furent envoyés à Dachau, dont des soldats soviétiques, qui furent éliminés, sans jamais avoir été inscrits sur les registres du camp. Tous les détenus furent traités avec une grande brutalité, mais il n'y eut jamais à Dachau d'extermination programmée ; et la chambre à gaz que l'on y construisit ne fut jamais utilisée.
Le 29 avril 1945, Dachau était libéré par la septième armée américaine. Plus de 650 responsables de Dachau furent jugés ; 260 d'entre eux furent condamnés à mort, les autres eurent des peines d'emprisonnement. A la fin de la guerre, Dachau fut pendant un certain temps utilisé comme camp de transit pour ceux qui attendaient d'être rapatriés dans leur pays d'origine.
Treblinka
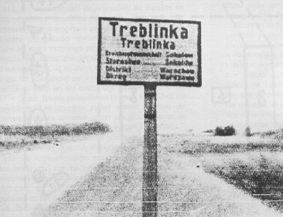
Situé à environ 80 kilomètres de Varsovie, dans une zone très boisée, Treblinka comprenait en fait deux camps : Treblinka I, qui fonctionna de décembre 1941 à juillet 1944, un camp punitif destiné avant tout aux Juifs avant leur extermination, et aux dissidents économiques et politiques polonais ; Treblinka II (que les documents officiels désignaient sous le sigle T.II), qui fut le plus tristement célèbre. Centre d'extermination, où plus de 870 000 prisonniers trouvèrent la mort, selon les statistiques polonaises officielles établies après la guerre par la commission nationale chargée d'enquêter sur les crimes nazis. Treblinka II fonctionna de juillet 1942 à octobre 1943.

Un des
très rares documents photographique de Treblinka:
Des prisonniers du Straflager tirent un chariot chargé de billes de
chemin de fer pour la préparation d'un bûcher en vue de l'incinération
des cadavres.
Le personnel des deux camps était composé d'une trentaine de SS, de 200 à 300 Ukrainiens, chargés essentiellement de la sécurité, et de 1 000 à 1 500 prisonniers juifs qui assuraient les tâches les plus pénibles après l'extermination de leurs codétenus ; déplacer les cadavres couverts de sang, d'urine et de matières fécales ; enlever les prothèses dentaires en or ainsi que tous autres objets précieux qui pouvaient être cachés, ce qui impliquait un examen rectal et vaginal. Outre les Juifs polonais, les détenus exterminés à Treblinka comprenaient des Juifs d'Allemagne, d'Autriche, de Bohême et de Moravie, de Slovaquie, des Pays-Bas, de Belgique, du Luxembourg, de Grèce et de Bulgarie, ainsi que des Tsiganes.
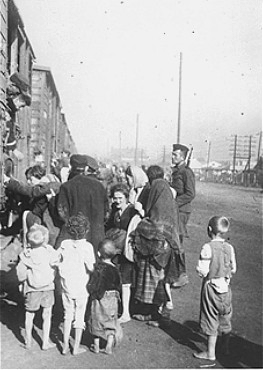
Sous l’œil des gardiens, des hommes, femmes et enfants juifs montent à bord de trains lors de la déportation de Siedlce vers le camp d’extermination de Treblinka. Siedlce, Pologne, août 1942.
Treblinka II fut un modèle d'efficacité exterminatrice. Dix chambre à gaz furent ajoutées aux deux premières, ce qui permettait de traiter vingt wagons de détenus à la fois : ces derniers étaient rassemblés dès leur descente du train, déshabillés, privés de leurs vêtements et possessions, et conduits directement dans les douches, puis dans les chambres à gaz. Avant leur construction, les cadavres étaient empilés dans d'immenses fosses et enterrés.
Les camps de Treblinka étaient placés sous le commandement du SS Franz Stangl, qui fut condamné à la prison à perpétuité en 1971, comme l'avaient été son assistant Kurt Franz et un certain Joseph (Sepp) Hirtreiter, tous deux en 1951. Neuf autres inculpés eurent des peines de deux à douze ans. Les procès des responsables de Treblinka se déroulèrent tous en Allemagne.
Dès l'ouverture du premier camp, il y eut des tentatives de résistance, la plus connue étant celle d'août 1943, date à laquelle les détenus se soulevèrent et beaucoup purent fuir. Mais, étant donné la situation isolée du camp et l'hostilité de la population paysanne des environs, peu d'entre eux réussirent à échapper aux nazis ; la plupart furent arrêtés et ceux qui avaient organisé le soulèvement furent pendus ou abattus.
Source : Steven L. Jacobs. Le livre noir de l'humanité. Encyclopédie mondiale des génocides. Editions Privat. 2001.