LE LIVRE NOIR : TEXTES ET TÉMOIGNAGES
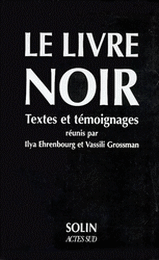
Le Livre noir est sans doute l'ouvrage pour lequel le proverbe latin : Habent sua fata libelli, les livres ont un destin, convient le mieux.
L'histoire du Livre noir ressemble à celle de notre pays. elle recèle de la même manière nombre de faits inexpliqués ou, comme il est convenu de dire aujourd'hui, de taches sombres. J'ai interrogé les gens qui avaient contribué à cette histoire, j'ai lu quantité de publications portant sur le sujet, puisque aussi bien il commence à en paraître chez nous, j'ai étudié les archives, et j'ai réussi à reconstituer en partie ce que fut l'épopée confuse et mouvementée du Livre noir.
Pendant la guerre, les soldats qui se battaient sur le front envoyaient à Ilya Ehrenbourg des quantités énormes de documents trouvés dans les territoires libérés de l'occupant, et lui rapportaient dans leurs lettres ce qu'ils avaient vu et entendu raconter. Ehrenbourg décida de rassembler les journaux intimes qu'ils avait reçus, les dernières lettres de condamnés, ainsi que les dépositions de témoins concernant l'extermination des Juifs par les nazis, et d'en composer un livre noir qu'il publierait. Il s'attaqua à cette tâche avec l'aide de l'écrivain Vassili Grossman : il fallait sélectionner les documents les plus éloquents, les raccourcir, éclaircir les points obscurs. Grossman et Ehrenbourg incitèrent un certain nombre d'écrivains et de journalistes à collaborer à l'ouvrage. Ainsi naquit la commission littéraire du Comité antifasciste juif.
Dès 1943, Ilya Ehrenbourg écrivait à l'un de ses lecteurs : Je travaille sur le Livre noir.
Au début de 1944, sous le titre Les auteurs d'un génocide, plusieurs fragments du futur ouvrage parurent dans la revue Znamia. Le recueil fut complété, et commença alors un véritable combat pour les faire éditer. La même année, Ehrenbourg prenait la parole au cours d'une réunion de la commission littéraire. Si l'on en croit le sténogramme, il aurait alors déclaré : On m'a dit : Faites un livre, s'il est bon, on le publiera. Je ne comprends toujours pas ce que veut dire ce s'il est bon : il ne s'agit pas d'un roman dont on ne connaîtrait pas le contenu...
En 1945, la commission littéraire met fin à ses activités : la publication du Livre noir est directement confiée au Comité antifasciste juif présidé à l'époque par S. Lozovski.
Ehrenbourg adresse une lettre à tous les membres de l'ancienne commission littéraire. Exprimant sa reconnaissance pour leur contribution, il ajoute : Je suis profondément convaincu que le travail que vous avez accompli ne sera pas perdu pour l'Histoire.
Le 5 avril 1945, Lozovski écrit à Ehrenbourg qu'il conviendrait de publier deux livres : le premier ne contiendrait que des documents, le second serait rédigé par Grossman et Ehrenbourg.
Le 26 février 1946, la nouvelle commission littéraire du Comité juif livre la conclusion suivante : Les deux variantes du Livre noir transmises à la commission pour examen ne présentent pas un texte répondant à une version définitive. La commission juge que, dans les exemples produits, une part excessive est consacrée au récit des actes ignobles commis par les traîtres à la patrie.
Néanmoins, la même année, paraît en Roumanie la première partie du Livre noir, tandis qu'à Moscou, Stronguine, rédacteur en chef de la maison d'édition de littérature juive, Der Emes (La Vérité), informe Grossman qu'il lui expédie l'original de l'ouvrage pour composition effective. Un rapport financier de I.Fefer, membre de la présidence du Comité antifasciste juif d'URSS, confirme que le Livre noir en version russe doit paraître aux éditions Der Emes et se trouve actuellement en cours de fabrication.
En 1947, Ehrenbourg confie au Musée juif de Vilnius deux albums de quatre cent treize pages rassemblant la substance du Livre noir, pour conservation temporaire et éventuelle utilisation.
Le 20 novembre 1948, quand le Comité antifasciste juif fut dissous, les châssis de composition du Livre noir furent détruits, on confisqua les premières épreuves et le manuscrit, écrit Ehrenbourg dans son livre Les Hommes, les Années, la Vie. A la même date, le Musée juif de Vilnius rendit à Ehrenbourg les dossiers qu'il lui avait confiés.
En 1960, le musée d'Histoire de Vilnius demanda que lui fût prêtée pour un temps la documentation rassemblée par Ehrenbourg sur l'extermination de la population juive par les fascistes. Un an après, Ehrenbourg exigea qu'elle lui fût restituée. J'en ai besoin pour mon travail, écrivit-il au musée. Les dossiers lui furent retournés.
En 1965, Ehrenbourg indique dans ses lettres : Des discussions sont en cours avec l' APN (1), pour publier le Livre noir. Mais rien ne sortit de ces démarches.
Le manuscrit atterrit à Jérusalem, et ce n'est qu'en 1980 que la maison d'édition israélienne Tarbut publia Le Livre noir en russe. Cependant, ainsi qu'il est dit dans la préface de l'ouvrage, plusieurs textes y manquaient, faute d'être parvenus en Israël.
En 1970, je découvrir, en triant les archives de mon père, les dossiers se rapportant au Livre noir. Sachant que le KGB s'y intéressait, je les confiai à la garde de différents personnes, et au début des années quatre-vingt, les fis parvenir à Jérusalem, au Yad Vashem -Institut de la mémoire des victimes du nazisme et des héros de la Résistance-, convaincue qu'ils y seraient en sûreté.
En janvier 1992, un ami m'a remis un jeu d'épreuves que Grossman lui avait offert autrefois. Il s'agissait de la version du Livre noir détruite en 1947 avant même d'être imprimée. Une main inconnue y avait inscrit :Epreuves corrigées, bon à tirer 14.6.47; suivait une signature illisible. C'est d'après ce jeu d'épreuves épargné par miracle que la présente édition a été établie.
Dans ses Mémoires, Ehrenbourg écrivait : J'ai consacré beaucoup de mes forces, de mon temps, de mon coeur, à travailler sur Le Livre noir... Je rêvais de le voir publié.
Plus de quarante-cinq ans ont passé (2), le rêve est devenu réalité.
Irina Ehrenbourg.
1. Agence de presse Novosti, également maison d'édition. (N.d.T)
2. Préface écrite pour la première édition en langue russe de 1993.
LETTRE D'ALBERT EINSTEIN A PROPOS DU LIVRE NOIR*
Ce livre rassemble des documents d'origine sur l'extermination systématique par laquelle le gouvernement allemand a assassiné une grande partie du peuple juif.
Ce sont les organisations juives, dont la collaboration a permis la réalisation de l'ouvrage rendu ici public, qui se portent garantes de la véracité des faits communiqués.
Il est vrai que cet objectif ne peut être atteint que si on se débarrasse du principe de non-ingérence, qui ces dernières décennies a joué un rôle si funeste. Personne maintenant ne peut plus douter de la nécessité d'accomplir ce pas lourd de conséquences. Car aujourd'hui il doit être évident, même pour quelqu'un ne visant qu'à une protection contre les agressions militaires, que les catastrophes provoquées par les guerres n'ont pas pour seule origine des préparatifs militaires et balistiques, mais qu'il faut y voir aussi la conséquence de la manière dont chaque État avait évolué.
C'est seulement lorsqu'on aura crée des conditions de vie non attentatoires à la dignité de l'homme, égales pour tous, qu'on aura assuré leur protection, et qu'elles seront reconnues et ressenties comme une obligation commune à tous les États et à tous les hommes, qu'on sera autorisé, dans une certaine mesure, à parler d'une humanité civilisée.
A ce sujet, autre chose doit être encore souligné. Pour de nombreuses années, l'existence matérielle des Juifs dans certaines parties de l'Europe sera impossible.
Suite à des décennies de dur labeur, et grâce au soutien financier spontané des autres peuples, les Juifs ont fait de nouveau de la Palestine une terre d'accueil. Tous ces sacrifices ont été consentis, car on avait confiance en la promesse faite officiellement après la Première Guerre mondiale par des gouvernements importants, qu'un asile sûr devait être donné au peuple juif sur sa vieille terre de Palestine. Cette promesse n'a été tenue que de manière partielle et hésitante, pour ne pas dire plus. Maintenant que les Juifs -en particulier ceux de Palestine- se sont distingués durant cette guerre, il est nécessaire de rappeler avec insistance cette promesse. On doit exiger que la Palestine, dans la mesure de ses capacités économiques, soit ouverte à l'immigration juive. Si des organisations supranationales obtiennent cette confiance, qui doit être au fondement même de leur existence, preuve doit alors avant tout être faite que ceux dont les sacrifices ont été les plus importants, et qui ont fait confiance à ces institutions , n'ont pas été trompés.
*Préface prévue pour l'édition américaine et retirée sous la pression des autorités soviétiques. (N.d.T.)
Source : Le Livre noir. Textes et témoignages réunis par Ilya Ehrenbourg et Vassili Grossman. Éditions Actes Sud. 1995 pour l'édition française.
L’autre face du génocide
Mille cent trente-six pages pour raconter le sort des centaines de milliers de martyrs du génocide commis par l’occupant nazi en Union soviétique: c’est le fameux Livre noir, dont le texte intégral vient, pour la première fois, de paraître en français (1).
Commandé en 1942 par le Comité antifasciste juif d’URSS aux journalistes-écrivains Ilya Ehrenbourg et Vassili Grossman, il rassemble les témoignages de correspondants de guerre soviétiques sur les massacres antisémites commis par les troupes allemandes et leurs collaborateurs. Mais l’oeuvre ne paraît pas. Car le Comité juif antifasciste, créé pendant la seconde guerre mondiale pour mobiliser les juifs du monde en faveur de l’Union soviétique, est victime, dès 1946, de la répression stalinienne contre le «cosmopolitisme», en premier lieu le «nationalisme juif». Ses dirigeants sont «jugés» en 1952, quand ils n’ont pas, comme le grand acteur Solomon Mikhoels, été assassinés avant. Saisi avant impression, Le Livre noir sera partiellement édité en Israël dans les années 70. Sa parution -dans la traduction du texte russe complet dont Ilya Ehrenbourg avait corrigé les épreuve- donne au lecteur français la mesure du rôle décisif joué par l’extermination des juifs soviétiques dans la mise en oeuvre de la «solution finale» planifiée lors de la conférence de Wannsee, en janvier 1942. C’est bien sur le «front de l’Est» que la SS a expérimenté l’anéantissement des juifs d’Europe. On l’oublie trop souvent.
Quand Hitler attaque l’Union soviétique en juin 1941, la guerre européenne prend un tournant capital, et la guerre contre les juifs entre dans sa phase finale. Les exécutants sont des unités spéciales de la police et de la SS, les Einsatzgruppen, qui avancent sur les talons de la Wehrmacht et procèdent à la mise à mort de dizaines de milliers d’hommes juifs.
Dans les régions annexées par l’Union soviétique en 1940, les pays baltes et l’Ukraine occidentale en particulier, des groupes anticommunistes locaux les secondent avec zèle, et les principales villes deviennent la scène de pogroms dont la violence excède les pouvoirs de l’imagination. Puis, au courant de l’été 1941, la tuerie prend une tournure systématique. Le cercle des victimes est élargi aux familles, aux femmes, aux enfants et aux vieillards indistinctement, les uns et les autres fusillés au bord ou au fond de fosses communes, après avoir été contraints d’abandonner leurs affaires et de retirer leurs vêtements.
A la fin de 1941, probablement 500000 juifs avaient été massacrés. Un nombre approximativement deux fois aussi élevé le seraient au cours de l’année suivante. Jamais encore la politique antisémite du IIIe Reich ne s’était faite aussi violente. Ce déchaînement, inscrit pour ainsi dire dans les gènes du nazisme, découlait logiquement de la définition qu’il avait construite de l’adversaire soviétique: non seulement puissance étatique, mais aussi et surtout puissance idéologique où confluaient les images de deux ennemis essentiels, le judaïsme et le bolchevisme, et subsidiairement celle du «sous-homme» slave. Autant de concepts fondateurs de l’identité nazie qui imprégnaient en même temps de larges strates de la société allemande.
Le caractère destructeur d’une guerre conçue dès le départ comme une «guerre d’anéantissement» allait être puissamment renforcé par la résistance inattendue de l’adversaire et par la perspective de plus en plus probable d’une extension du conflit, qui intervint à la fin de 1941 avec l’entrée en guerre des États-Unis. Or le passage à la guerre totale non seulement exacerba la fureur meurtrière des nazis, qui y virent une machination juive visant à détruire l’Allemagne, mais elle fournit les conditions favorables à leurs crimes. Alors que, pendant la campagne de Pologne, les chefs de la Wehrmacht avaient mis le holà aux actions de la SS contre les élites polonaises et contre les juifs, ils apportèrent en Russie, dans le droit fil de leur anticommunisme et de leur antisémitisme, une aide substantielle aux sbires de Himmler.
Dans l’ambiance crépusculaire que répandait la prolongation d’une guerre de plus en plus éprouvante, les élites et la population allemandes allaient serrer les rangs, et fermer les yeux et les oreilles. Mais le déchaînement de l’été 1941 importe aussi et surtout parce qu’il se prolongea dans l’extermination de tous les juifs de l’Europe nazie. La vague meurtrière lancée vers l’est repartait bientôt vers l’ouest pour englober l’ensemble du continent. Même si la chronologie, les modalités et les motivations de cette décision restent objets de débat pour les historiens, il est certain du moins que les préparatifs en vue d’une extermination à l’échelle européenne ne furent entamés qu’après l’attaque contre l’Union soviétique. Et, s’il est loisible de débattre de leur rapport exact avec les vicissitudes de la campagne à l’Est, il demeure que les massacres sur le sol soviétique furent une étape décisive du génocide, dont ils constituent une face à part entière, et trop souvent oubliée.
Étape décisive, parce que c’est dans les plaines de l’Est que la SS fit l’apprentissage de la tuerie de masse. Chose qui n’allait pas de soi, même pour des troupes idéologiquement aguerries, et dont les effets se firent sentir par la suite dans toute l’Europe nazie: en 1943-1944, les actions répressives les plus sanglantes menées par les Allemands en France seraient le fait d’hommes qui appartinrent aux Einsatzgruppen en 1941-1942. C’est aussi en Union soviétique, et dès l’été 1941, que Himmler, prenant la mesure de l’énorme tâche à accomplir et des problèmes psychosomatiques qu’elle engendrait chez ses exécutants, comprit qu’il fallait chercher des moyens plus efficaces et moins éprouvants. Le bricolage improvisé de camions spéciaux, dont les gaz d’échappement étaient utilisés pour asphyxier les personnes enfermées à l’intérieur, fut un pas important vers l’invention de l’extermination industrielle. Le premier centre de mise à mort, celui de Chelmno, créé à la fin de 1941, s’en inspira directement puisqu’il allait fonctionner avec un moteur Diesel, avant que l’emploi à Auschwitz d’un désinfectant puissant, le Zyklon B, s’imposât comme la solution de loin la plus efficace.
Une barbarie primitive TERRAIN d’apprentissage et champ d’expérimentation, l’Union soviétique occupée fut même prévue initialement comme le lieu d’assassinat des juifs d’Europe. Ce fut, de fait, la destination mortelle des premiers convois de juifs déportés d’Allemagne en automne 1941. En définitive, les camps d’extermination furent installés plus à l’ouest, sur le territoire de l’ancienne Pologne, donnant naissance à deux pratiques divergentes. Tandis que les nazis transportaient les juifs du reste de l’Europe vers les camps de Pologne, ils continuèrent, en Union soviétique, à aller se saisir d’eux sur les lieux de résidence et à les tuer par les méthodes habituelles. Affaire de distances et de capacités de transport, sans doute, mais aussi logique d’une politique de terreur conçue pour pacifier les arrières dans le cadre d’une «guerre d’anéantissement» qui ferait, en dehors des juifs, des millions de morts, parmi les prisonniers de guerre comme parmi la population civile.
C’est donc une autre face du génocide que montre la politique nazie en Union soviétique. Ici, point de mort administrée comme dans les camps d’extermination, au terme d’un transport plus ou moins long, mort que les bourreaux déguisent du mieux possible en opération d’hygiène et qu’ils infligent de manière quasi clinique, avant de faire partir en fumée les cadavres de leurs victimes, d’effacer la trace d’un passage d’homme sur cette terre. Mais une mort violente, sanglante, infamante, qu’il n’est même pas possible de qualifier de boucherie tant fait défaut la méthode du boucher: personnes rouées de coups de crosse, accumulation de blessés et d’agonisants dans des fosses bruissantes de râles et de gémissements et qui seront fermées sur bien des respirations, tueurs pris de boisson et ruisselant du sang de leurs victimes.
Ces massacres à ciel ouvert commis dans le voisinage d’innombrables localités, il n’était même pas question de les tenir secrets, ni pour les populations locales ni pour les troupes allemandes. A la différence de ce qui se passa pour les camps d’extermination, les nouvelles, en dépit des barrages dressés par les autorités, filtrèrent très rapidement, vers l’Allemagne d’abord. Les traces des fosses communes qui jonchaient le territoire soviétique, et qu’un renversement de la situation militaire pouvait rendre compromettantes, devaient être supprimées. Himmler confia donc à une équipe spéciale le soin de déterrer et de brûler les myriades de cadavres qu’elles contenaient. Cette tâche immonde, des juifs durent l’accomplir, avant d’être à leur tour assassinés et brûlés sur des bûchers d’occasion arrosés d’essence.
Auschwitz est devenu à bon droit le synonyme d’un génocide sans précédent et sans équivalent par la combinaison qui le caractérise de fanatisme idéologique, de rigueur administrative et de méthode industrielle. Mais cela ne saurait faire oublier ce qui s’est passé dans les plaines de l’Est, et n’a d’ailleurs, à ma connaissance, jamais fait l’objet d’une tentative de négation. Ce qui s’y donne à voir du nazisme, ce n’est pas sa modernité, notion aussi difficile à éviter qu’à définir précisément, mais bien au contraire cette face de barbarie primitive qui a trouvé dans Le Livre noir un témoignage saisissant.
Article de Philippe Burrin