LA RÉVOLTE JUIVE DANS LES GHETTOS ET LES CAMPS
L' ATTITUDE DES JUIFS FACE A LA SHOAH
Sur l'attitude des Juifs face à la Shoah, les controverses n'ont cessé de faire rage depuis la fin de la guerre. Provoquant des affrontements passionnés, soit entre survivants soit parmi les nouvelles générations, elles ont opposé, principalement dans les milieux juifs, les historiens aussi bien que les théologiens, les philosophes et les sociologues aussi bien que les publicistes et les hommes politiques. Aussi a-t-on vu soutenir les positions les plus radicales et les polémiques atteindre une rare violence.
Pourtant, il conviendrait avant toute discussion de souligner l'extrême diversité des attitudes en fonction de multiples facteurs : l'âge, le lieu (les différences de comportement comme de situation ont été considérables entre l'est et l'ouest de l'Europe), l'origine sociale et culturelle, les traditions religieuses et politiques, etc. En fait les débats se sont noués autour de trois problèmes clefs :
- la résistance juive ;
- les conseils juifs ;
- la passivité des victimes.
1) Sur la résistance juive s'est développée toute une littérature, mêlant témoignages et travaux scientifiques, avant tout pour répondre, de manière explicite ou implicite, à l'accusation souvent formulée d'après laquelle les Juifs se seraient laissé massacrer sans réagir : comme des agneaux conduits à l'abattoir selon l'expression consacrée. On a donc mis en évidence les nombreux actes d'opposition, de rébellion ou de lutte accomplis par des Juifs durant la guerre.
Mais le mot résistance peut lui-même recouvrir plusieurs types d'activité. Certains par exemple y englobent le travail clandestin - qui a été considérable - de sauvetage et d'entraide. D'autres considèrent comme une forme de résistance le refus de désespérer, la volonté de préserver l'identité juive et de protéger l'âme et le corps de la communauté. Par ailleurs, où classer les Juifs qui en grand nombre ont participé à la résistance européenne en général, dans des mouvements, des réseaux, des unités de maquis ou de partisans qui n'avaient rien de spécifiquement juif, mais qui luttaient contre l'ennemi commun ?
La plupart des auteurs, toutefois, ont préféré insister sur l'action armée, c'est-à-dire sur les groupes de combat organisés, dirigés et composés par des Juifs. Là prédominaient en général des éléments jeunes -décidés à faire coûte que coûte quelques chose les armes à la main contre l'oppresseur- ainsi que des éléments issus soit du sionisme soit du mouvement communiste international soit encore, en Pologne, du Bund (le parti socialiste juif polonais). Malgré la disproportion des forces, une lutte désespérée s'est engagée entre ces petits noyaux résolus à défier leurs bourreaux et les occupants allemands.
C'est ainsi qu'en Europe de l'Est des groupes de partisans juifs, s'abritant dans les forêts et les marais, on réussit à opérer en Pologne orientale, en Lituanie (on en compte une dizaine de milliers en 1941-1942), en Biélorussie (où l'on trouve des effectifs équivalents vers 1943). En France la lutte menée par les communistes juifs de la Main-d'oeuvre immigrée ou MOI, après avoir longtemps occultée, a depuis le milieu des années 1980 attiré l'attention grâce à un film télévisé (Des terroristes à la retraite) et à plusieurs livres.
Mais l'épisode le plus connu, parce que le plus héroïque et le plus symbolique, c'est le soulèvement du ghetto de Varsovie du 19 avril au 16 mai 1943. Sans avoir d'illusion sur l'issue (nous disparaîtrons sans laisser de traces, écrivait l'un d'entre eux), des combattants de l'Organisation juive de combat, au nombre de moins d'un millier, retranchés dans les décombres du ghetto (où survivaient encore quelques 50 000 personnes), munis d'un armement de fortune, ont réussi à tenir tête à 2 500 SS pendant quatre semaines. S'ils périrent dans leur grande majorité, quelques dizaines parvinrent à s'échapper et à transmettre le souvenir de cette épopée.
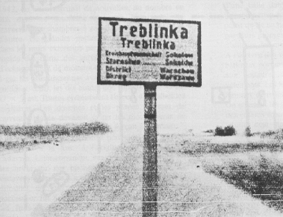
Enfin il faut faire une place à part aux révoltes de déportés dans les camps. A plusieurs reprises en effet, malgré les énormes difficultés techniques et les minces chances de réussite, des groupes de détenus juifs se sont rebellés et ont tenté de s'enfuir : révoltes de Treblinka le 2 août 1943 (12 survivants), de Sobibor le 14 octobre 1943 (sur plusieurs centaines de prisonniers échappés, la plupart sont repris et tués), d'Auschwitz où le 7 octobre 1944 les membres d'un Sonderkommandose soulèvent, tuent quelques SS, détruisent un crematorium, mais sont presque tous massacrés au cours de la lutte ou après avoir été capturés. Au bout du compte on a calculé qu'il y avait eu 76 évasions réussies sur un total de 667 tentatives.
2) Sur la question des conseils juifs (et dans le cas français de l'UGIF, l'Union générale des Israélites de France), les batailles n'ont pas été moins violentes. En effet les autorités nazies, pour atteindre leurs objectifs, avaient imaginé d'utiliser au plan local les structures traditionnelles des communautés juives. C'est ainsi que dans chaque ville importante et chaque ghetto, d'Amsterdam à Varsovie, de Prague à Salonique, de Budapest à Minsk, les Juifs ont été obligés de former des conseils juifs ou Judenräte, chargés d'apporter un concours administratif aux Allemands en gérant la vie quotidienne de leurs coreligionnaires dans le domaine de l'économie, du ravitaillement, de la police, de l'hygiène, du culte, de l'enseignement, etc.
Dans ces communautés ravagées par les privations, l'épuisement, la faim et la maladie, en proie à la terreur permanente, sous l'empire d'une menace omniprésente, chaque Judenrät (ou en France l'UGIF) a dû pratiquer la politique du moindre mal. D'où les reproches faits après la guerre à ces organismes accusés d'avoir coopéré avec les nazis et par là d'avoir facilité le travail des bourreaux. En fait la question est très complexe, car l'attitude des Judenräte, comme de l'UGIF, loin d'avoir été uniforme, a varié selon les individus, les lieux, les circonstances, beaucoup s'efforçant en sous-main de sauver tout ce qui pouvait être sauvé, mais d'autres se prêtant, par naïveté ou aveuglement ou bien sous l'effet d'une spirale de pressions graduelles, aux faux-calculs d'une protection illusoire.
3) A propos des discussions sur ce qu'on a appelé la passivité juive, il convient d'abord de préciser la signification d'un terme au demeurant fort ambigu. Si l'on entend par là une forme de résignation qui serait spécifiquement juive, un comportement en quelque sorte caractéristique de la judéité, le produit d'un héritage culturel séculaire fait de soumission au pouvoir en place, bref la marque d'une minorité persécutée qui n'a dû sa survie à travers les âges qu'à une pratique méthodique de la dépendance docile, alors il faut comparer l'attitude des Juifs persécutés avec celle de millions d'Européens occupés et captifs qui, dans des conditions infiniment moins tragiques, ont fait preuve d'une apathie persistante sans manifester ni réaction de refus ni esprit de rébellion, qui se sont laissé ballotter en tous sens à travers l'Europe, et qui au total se sont contentés de subir, tantôt résignés tantôt apeurés, mais en sauvant leur peau, les épreuves de la domination allemande au jour le jour.
De surcroît, parmi les Juifs, l'ignorance était la règle. Au moment des rafles ou dans les convois les emmenant vers les camps de la mort, bien peu réalisaient qu'ils étaient déportés pour être exterminés jusqu'au dernier. Dans leur immense majorité les victimes croyaient qu'ont les transportait dans des camps de travail en Pologne (à Pitchipoï, disait-on à Drancy). Des rumeurs ont circulé, mais la plupart ont refusé d'y croire et n'ont découvert la vérité qu'à leur arrivée à Treblinka ou à Auschwitz. Comment d'ailleurs auraient-ils imaginer l'inimaginable ?
Source : Le génocide et le nazisme. François Bédarida. Presses Pocket. 1992.
LA RESISTANCE DANS LES GHETTOS

Forces allemandes aux abords de Varsovie. En arrière plan de la photo, la ville brûle du fait de l’attaque militaire allemande. Varsovie, Pologne, septembre 1939.
Entre 1941 et 1943, des mouvements de résistance clandestins se développèrent dans une centaine de ghettos en Europe orientale sous occupation nazie (soit environ un quart des ghettos), en Pologne, en Lituanie, en Biélorussie et en Ukraine. Leur but était d'organiser des soulèvements, des évasions des ghettos pour rejoindre les unités de partisans dans la lutte contre les Allemands.
Les Juifs savaient que les soulèvements n'arrêteraient pas les Allemands, et que seul un petit nombre de combattants pourrait s'échapper avec succès et rejoindre les partisans. Malgré cela, ils décidèrent de résister. Des armes furent introduites en contrebande dans les ghettos. Les habitants des ghettos de Vilno, Mir, Lachva, Kremenets, Czestochowa, Nesvizh, Sosnowiec et Tarnow, entre autres, opposèrent une résistance farouche lorsque les Allemands commencèrent à déporter les populations des ghettos. A Bialystok, l'organisation clandestine conduisit une insurrection juste avant la destruction finale du ghetto en 1943. La plupart des combattants, des jeunes hommes et femmes, moururent au combat.
L' ORGANISATION UNIE DES PARTISANS DU GHETTO DE VILNA (FPO) (1)

Groupe de résistants au ghetto de Vilno
Premier appel
Ne nous laissons pas immoler comme des brebis !
Jeunes Juifs, ne croyez pas les menteurs. Sur les quatre-vingt mille Juifs de Vilna vingt mille seulement restent encore en vie. Sous nos yeux, on a emmené nos parents, nos frères, nos soeurs. Où sont les centaines de personnes arrêtées par la police de la ville soi-disant pour être envoyées au travail ? Où sont les femmes et les enfants qu'on a emmenés à moitié nus pendant la terrible nuit du premier massacre ? Où sont passés tous les Juifs arrêtés dans les synagogues le jour du Kippour ?
Celui que l'on emmené hors du ghetto ne reviendra plus jamais, parce qu'à partir de la Gestapo, tous les chemins mènent à Ponary et Ponary, c'est la mort.
Ponary n'est pas un camp. Là-bas on fusille tout le monde. Hitler a décidé d'exterminer tous les Juifs d'Europe. Nous sommes ses premières victimes.
Ne nous laissons pas immoler comme des brebis ! Il est vrai que nous sommes faibles, que nous ne pouvons compter sur aucune aide extérieure, mais il n'y a qu'une réponse digne à faire à l'ennemi, c'est de résister.
Frères ! Il vaut mieux périr libres les armes à la main plutôt que vivre soumis, graciés par les meurtriers. Luttons jusqu'au dernier souffle !
1er Janvier 1942. Ghetto de Vilna.
Tel était le texte du premier appel (2) . Ce fut un éclair qui brilla dans les ténèbres du ghetto. On le lut lors d'une réunion du groupe d'initiative, où l'on examina également le témoignage de l'institutrice Katz, revenue d'une fosse de Ponary peu de temps auparavant. Blessée de plusieurs balles, elle était sortie de la sépulture pendant la nuit et avait rampé jusqu'à la ville, à moitié nue.
On avait conduit l'institutrice ensanglantée à la réunion : connue de tous comme une femme raisonnable, honnête, elle allait communiquer à tous le désir de se venger, la volonté de se battre.
Dès le début, des groupes de résistance armée s'étaient créés spontanément dans le ghetto.
Le 21 décembre 1941 (3) lors d'un massacre, eut lieu le premier cas de résistance active. Rue de l'Hôpital, vingt personnes se cachaient dans une cave. La police, qui parcourait le ghetto avec des haches et des chiens, découvrit cette planque et ordonna à tout le monde de quitter la cave. Les gens refusèrent. Alors, Schweinberger força l'entrée de la cave avec une bande de policiers. Deux jeunes gens, Gaus et Goldstein, qui n'étaient pas armés, se jetèrent sur les bandits.
Après une lutte qui dura près d'une heure, les vingt personnes moururent héroïquement. Les policiers allemands payèrent leur mort de nombreuses mutilations et blessures graves.
Le lendemain, des tracts furent collés sur les murs des maisons du ghetto :
Gloire éternelle à Gaus et à Goldstein. Gloire éternelle à nos morts !.
(1) L'organisation, créée le 21 janvier 1942, s'appelait en yiddish Fareinigte partisaner organisazie, Organisation unie de partisans.
(2) Cet appel fut écrit par Aba Kovner.
(3) L'action dite des Scheine roses.
Extrait de l'ouvrage Le livre noir. Sur l'extermination scélérate des Juifs par les envahisseurs fascistes allemands dans les régions provisoirement occupées de l'URSS et dans les camps d'extermination en Pologne pendant la guerre de 1941-1945. Actes Sud, 1995.
L' ORGANISATION DE LA RÉSISTANCE JUIVE
Le 23 juillet 1942, au lendemain du suicide d'Adam Czeniakov, président du Judenrat, date qui marquait le premier jour de la déportation massive des Juifs de Varsovie, le Bund, le Tsukunft et les syndicats se réunirent. Y participèrent notamment, Bernard Goldstein, Abracha Blum, Abralm Berek Scneidmil, Wolf Rozowski, Moritz (Marek) Orzech et Marek Edelman. Ils décidèrent de se concerter avec les autres mouvements pour discuter de l'éventualité d'une insurrection. Un militant devait partir enquêter sur place sur le sort réservé à ceux que l'on emmenait dans les camps de travail. Un tract rédigé par Moritz Orzech intitulé Soyons sur nos gardes, expliquait aux Juifs de Varsovie que leurs frères partaient à la mort.
Depuis le printemps 1942, le Bund savait à quoi s'en tenir. Dans son rapport, Marek Edelman disait que le mois d'avril 1942 marquait un tournant dans le destin juif, parce que les arrestations, les tueries, les exécutions, démontraient que l'atmosphère s'alourdissait au ghetto. Les gens prenaient conscience que le ghetto serait liquidé. Le Bund était au courant de ce qui se passait dans différents coins de Pologne. Il fit parvenir régulièrement à l'extérieur des comptes rendus détaillés. Celui de mai 1942 mentionnait les déportations, les exécutions sommaires, les opérations de gazage à Chelmno. Les Allemands ont déjà tué plus de 700 000 Juifs en Pologne, indiquait-il. Venant des ghettos voisins, de Bialystok et de Wilno, des courriers annonçaient des nouvelles tragiques, la passivité et l'indifférence des Polonais. Ce que le Bund ne savait pas, c'est que la question juive était réglée à l'échelle de toute l'Europe par la solution finale.
Zalman Frydrych (Zygmun) fut désigné par le parti ouvrier juif pour observer sur place la destination des trains qui quittaient quotidiennement Varsovie et revenaient à vide. Il revint au ghetto et fournit des renseignements détaillés sur le centre de mise à mort de Treblinka. Sa description ne put empêcher des membres du comité central de demeurer incrédules, ne pouvant imaginer l'inimaginable. La population juive y crut encore moins.
De septembre à décembre, le Bund et le Tsukunft nouèrent de multiples contacts avec les organisations juives, He'haloutz, Hashomer Hatzaïr, Dror, Akiba, Poalé Tsion de gauche et de droite, et les communistes. Les relations s'intensifièrent auprès de l'Armia Krajowa et de la Guardia Ludowa. Les armes furent achetées à prix d'or. Mikhaïl Klepfisz, ingénieur de formation, avec une équipe de volontaires, confectionna des cocktails Molotov. Selon Daniel Tollet, l'Armia Krajowa aurait fourni 90 pistolets avec leurs munitions, 600 grenades, 15 kg de plastic et quelques mitraillettes. Le parti ouvrier polonais, 10 carabines et 30 pistolets. Selon Borwicz, l'armement était légèrement supérieur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aide fournie par la résistance polonaise était minime. Les combattants juifs demeurèrent tragiquement isolés.
Le 2 décembre 1942, l'Organisation juive de combat (ZOB) fut fondée. Sur les seize groupes de combat, 4 appartenaient au Bund. A l'OJC s'ajoutèrent 400 combattants de l'Association militaire juive, des éléments de la droite sioniste-révisionniste. Il restait environ de 50 000 à 60 000 âmes à Varsovie.
Source : Histoire générale du Bund : un mouvement révolutionnaire juif. Henri Minczeles. Éditions Austral, Paris, 1995.
LA RÉSISTANCE DANS LES CAMPS
Dans les conditions les plus défavorables, des prisonniers juifs réussirent à organiser la résistance et des soulèvements dans certains camps nazis. Les travailleurs juifs survivants se soulevèrent dans les camps d'extermination de Treblinka, Sobibor et Auschwitz-Birkenau, soit dans trois des six camps d'extermination. Environ 1 000 prisonniers juifs participèrent au soulèvement de Treblinka. Le 2 août 1943, les Juifs s'emparèrent de toutes les armes qu'ils purent trouver -piques, haches et un petit nombre d'armes à feu volées dans l'armurerie du camp- et mirent le feu au camp. Environ 200 parvinrent à s'échapper. Les Allemands reprirent et abattirent environ la moitié d'entre eux.
Le 14 octobre 1943, des prisonniers de Sobibor tuèrent 11 gardes SS et auxiliaires de police, et mirent le feu au camp. Environ 300 prisonniers s'échappèrent en perçant une brèche dans le réseau de fils de fer barbelés et en risquant leur vie dans le champ de mines qui entourait le camp. Plus de 100 d'entre eux furent repris, puis exécutés.
Le 7 octobre 1944, des prisonniers affectés au four crématoire IV d'Auschwitz -Birkenau se révoltèrent après avoir appris qu'ils allaient être tués. Les Allemands écrasèrent la révolte et tuèrent pratiquement la totalité des centaines de prisonniers qui avaient participé à la rébellion.
D'autres soulèvements se produisirent dans les camps de Kruszyna (1942), Minsk-Mazowiecki (1943) et Janowska (1943). Dans plusieurs douzaines de camps, les prisonniers organisèrent des évasions pour rejoindre les unités de partisans. Des évasions réussirent, par exemple, dans le camp de travail de la rue Lipowa à Lublin.
Bien qu'étant largement sous-armés et en sous-effectifs, les Juifs des ghettos et des camps résistèrent par la force aux Allemands. L'esprit de ces révoltes transcenda leur échec à arrêter le génocide.
L'essentiel de la résistance juive armée se déploya après 1942, dans un effort désespéré, lorsqu'il apparut clairement que les nazis avaient assassiné la plupart des membres de leurs familles et de leurs coreligionnaires. Malgré des obstacles importants (comme le manque d'armes et d'entraînement, l'organisation d'opérations en zone hostile, la réticence à laisser derrière eux les membres de leurs familles et l'omniprésence de la terreur nazie), de nombreux Juifs, dans toute l'Europe sous occupation allemande, tentèrent d'opposer aux Allemands une résistance armée. Que ce soit individuellement ou en groupes, les Juifs s'engagèrent dans des actions de résistance, contre les Allemands et leurs alliés au sein de l'Axe. Des unités spécifiques de résistance juive combattirent en France, en Belgique, en Ukraine, en Biélorussie, en Lituanie et en Pologne. Des Juifs combattirent également au sein d'organisations de résistance, en France, en Italie, en Yougoslavie, en Grèce et en Union soviétique.
LA RESISTANCE
JUIVE ARMEE EN EUROPE ORIENTALE
En Europe orientale, des unités juives combattirent les Allemands dans
les ghettos et derrière les lignes de front, dans les forêts.
L'essentiel de la résistance armée juive débuta en 1943. Toutefois, il
convient de noter que des mouvements de résistance générale dans les
régions, combattant dans des conditions plus favorables et bénéficiant
d'une plus grande sympathie de la part des populations locales, ne
commencèrent pas non plus à combattre avant 1943.
Malgré un soutien minime et même une certaine hostilité liée à l'antisémitisme des populations locales, des milliers de Juifs combattirent les Allemands en Europe orientale. Des unités de résistance apparurent dans plus de 100 ghettos en Pologne, en Lituanie, en Biélorussie et en Ukraine. Les Juifs résistèrent lorsque les Allemands tentèrent de mettre en place des ghettos dans un certain nombre de petites villes de Pologne orientale, en 1942. Des révoltes eurent lieu à Starodubsk, Kletsk, Lachva, Mir, Tuchin, et dans plusieurs autres villes. Lorsque les Allemands liquidèrent les ghettos en 1943, ils durent faire face à la résistance juive armée à Cracovie, Bialystok, Czestochowa, Bedzin, Sosnowiec et Tarnow, ainsi qu'à un soulèvement majeur à Varsovie. Des milliers de Juifs s'enfuirent des ghettos et rejoignirent les unités de partisans dans les forêts environnantes. Des Juifs de Minsk, par exemple, créèrent sept unités de combat de partisans. Des Juifs de Vilno, Riga et Kovno formèrent également des groupes de résistance.
En Biélorussie occidentale, en Ukraine occidentale et dans l'Est de le Pologne, furent créés des camps familiaux de résistance dans lesquels les civils juifs réparaient les armes, fabriquaient des vêtements, préparaient les repas des combattants et assistaient les partisans soviétiques dans leurs opérations. Quelque 10 000 Juifs survécurent à la guerre en se réfugiant auprès d'unités de partisans juifs. Le camp créé par Tuvia Bielski dans la forêt de Naliboki en 1942, par exemple, offrit un refuge à 1 200 Juifs.
Il y eut même des soulèvements dans les camps d'extermination de Treblinka, Sobibor et Auschwitz en 1943 et 1944.
LA RESISTANCE
JUIVE ARMEE EN EUROPE OCCIDENTALE
En France, l'Armée Juive, un groupe de partisans juifs français, fut
créée à Toulouse en janvier 1942. Composée de membres des mouvements de
jeunesse sionistes, l'Armée Juive combattit à Toulouse, Nice, Lyon et
Paris et dans les environs de ces villes. Ses membres firent passer en
contrebande de l'argent de Suisse en France pour aider les Juifs à se
cacher. Ils permirent à plus de 500 Juifs et non-Juifs de se rendre en
Espagne, pays neutre, et participèrent en 1944 à des combats contre les
Allemands à Paris, Lyon et Toulouse. Solidarité, une unité communiste
juive de résistance, conduisit également des attaques contre les
occupants allemands à Paris. De nombreux Juifs rejoignirent également la
résistance française.
En Belgique, une unité de résistance comprenant des Juifs et des non-Juifs (appelée également Solidarité) fit dérailler un train de déportation en avril 1943. Le 25 juillet 1942, des résistants Juifs attaquèrent et mirent le feu aux fichiers de l'Organisation des Juifs de Belgique que les Nazis avaient imposée. Les Juifs furent également actifs dans les mouvements clandestins néerlandais et italiens.
L'impact de la résistance armée juive ne doit cependant pas être exagéré. Elle ne pu faire que peu de choses pour empêcher les nazis de mettre en oeuvre les massacres de masse. L'essentiel de la résistance juive contre les nazis travaillait surtout à des opérations de secours, aidait les gens à se cacher ou à s'enfuir, et tentait d'apporter une assistance psychologique pour résister aux persécutions. Néanmoins, la résistance armée organisée fut la forme la plus directe de l'opposition juive aux nazis.
Source : Copyright © United States HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM, Wafhington, D,C; Translation copyright © Mémorial de la Shoah, Paris, France
La révolte et la fin du camp de Sobibor

Le 5 juillet 1943, Himmler, qui a visité le camp en février, ordonne de transformer Sobibor en camp de concentration et d’y monter un kommando pour récupérer et démonter les munitions prises à l’ennemi... En effet les juifs du «Generalgouvernement» sont pratiquement tous exterminés, et Birkenau tourne à plein régime, rendant l’Aktion Reinhard caduque. Les déportés commencent à édifier de vastes entrepôts où seront stockées les armes et les munitions récupérées sur l'année Rouge. Un convoi de déportés provenant d'URSS arrivé à Sobibor le 23 septembre, est tout entier épargné et affecté à la construction de ces nouveaux baraquements...
Cet ordre signifie l'arrêt de mort des kommandos de prisonniers juifs qui travaillent aux quais et aux chambres à gaz. Témoins de l'extermination de dizaines de milliers d'innocents, ils savent qu’ils n’ont aucune chance de rester en vie. Ils sont environ 600 déportés juifs, dont 80 femmes. Ils savent que le 2 août 1943, les déportés de Treblinka se sont révoltés. Ils décident donc d'organiser un mouvement de résistance sous les ordres de Léon Feldhendler.
Léon Feldhendler est secondé aidé par Alexander Pechersky, «Sacha», un juif prisonnier de guerre d'origine russe arrivé au camp en septembre 1943. La révolte éclate le 14 octobre 1943. Au cours du combat, 11 SS ainsi qu'un certain nombre de gardes ukrainiens sont tués. Près de 300 prisonniers juifs s'évadent, mais des dizaines d'entre eux sautent sur les mines entourant le camp…

Portrait de groupe de quelques-uns des participants au soulèvement du camp d’extermination de Sobibor. Pologne, août 1944.
Depuis le 7 juillet 1943, Globocnick est remplacé par le général SS Jacob Sporrenberg. Himmler charge d'écraser la révolte de Sobibor et fait appel, tout comme le général Stroop à Varsovie en avril 1943, au concours de la Wehrmacht et de la Luftwaffe, et réussit à l'obtenir. Sporrenberg ordonne de cruelles représailles. Les insurgés retrouvés dans les forêts voisines sont abattus sur place ou ramenés au camp. Ils y seront torturés, puis passés par les armes. En tout et pour tout, seuls 50 prisonniers survivront à la guerre. Ils témoigneront…
Le 19 octobre 1943 Globocnik achève l’opération Reinhard, et part avec Wirth, Stangl et la plupart des SS des centres de mise à mort en Istrie où il est nommé chef suprême de la police SS. Himmler décide la destruction de Sobibor. Les sapeurs de la Wehrmacht démontent les installations, dynamitent les chambres à gaz, les villas des SS et les bâtiments en dur, incendient les baraques. Comme à Belzec, le terrain est labouré et planté de pins afin de dissimuler les traces de l'extermination. En novembre 1943, tout est terminé.
Eté 1944: quelques jours avant d’atteindre Lublin, l’Armée Rouge traverse le site de Sobibor…
Source : ©2007-2010 B § S Editions Tous droits réservés.
Juifs dans la Résistance, résistances juives et révoltes armées
Tous les Juifs n'ont pas passivement accepté leur destin. Un certain nombre se sont suicidés, parfois par familles entières, plutôt que de se laisser déporter. Des Juifs ont refusé d'embarquer lors de transports, ainsi à Przemysl, à Bialystok, etc. En général, ils l'ont payé aussitôt de leur vie.
Au rebours des légendes antisémites sur la «lâcheté juive», les israélites sont surreprésentés dans les mouvements de la Résistance intérieure et extérieure, et ce à travers toute l'Europe occupée. Ainsi, les Juifs de France comptent pour 5% des compagnons de la Libération, alors qu'ils sont moins de 1% de la population. Des milliers ont laissé la vie dans les Résistances de chaque pays.
Toutefois, surtout en Occident, beaucoup de ces résistants juifs sont des «assimilés» qui ne se considèrent pas ou plus comme juifs, et qui ne résistent pas en tant que Juifs. De ce fait, ils se refusent fréquemment à porter une attention particulière au sort des Juifs, de crainte d'être accusés de privilégier un groupe de victimes par rapport aux autres, et de ne se soucier que de leurs coreligionnaires. Généralement, ils ont cru qu'il fallait avant tout se préoccuper de gagner la guerre, et que la victoire arrêterait la persécution et ferait revenir les déportés. Ils n'ont pas eu conscience de l'anéantissement spécifique - et difficilement imaginable - qui attendait leur propre peuple.
Une Résistance spécifiquement juive a aussi existé, mais elle n'a pas nécessairement non plus fait pour autant de la lutte contre la déportation une priorité. Ainsi les bataillons juifs de la MOI en France, liés au PCF, se sont-ils avant tout investis dans le sabotage ou les attentats contre les forces d'occupation.
La résistance armée juive notamment en Europe de l'Est se heurte à d'importants obstacles structurels. Dépourvus d'expérience des armes par des siècles de discrimination, la plupart des Juifs ignorent leur usage, ni ne peuvent souvent se résoudre à briser le tabou culturel et religieux de la violence. Le fatalisme d'inspiration religieuse a parfois pu jouer son rôle. Les éléments les plus susceptibles de se battre ont émigré en Palestine avant-guerre ou, en URSS, sont mobilisés dans l'Armée rouge. Les armes sont extrêmement difficiles à se procurer. On ne peut souvent escompter de l'aide de mouvements de résistance locaux, pas toujours exempts eux-mêmes de préjugés voire de violences antisémites. La terreur permanente fait que beaucoup préfèrent négocier ou plier l'échine que tenter une lutte isolée, sans espoir, radicalement inégale, qui précipiterait des représailles meurtrières. La grande majorité des Juifs cherche d'abord à survivre et à se nourrir. Enfin, les divisions politiques, sociales et religieuses traditionnellement vivaces au sein des communautés n'arrangent rien.
En Europe de l'Est, dans les ghettos, la résistance finit cependant par s'organiser: c'est le cas en URSS à Riga, à Kaunas, et même à Vilnius. Dès décembre 1941, l'Organisation des combattants de Minsk rejoint les rangs des premiers partisans soviétiques. Un soulèvement armé est signalé dès le 20 juillet 1942 à Nesvizh en Biélorussie, et plusieurs autres ghettos se révoltent également cet été-là. En général, ces soulèvements s'accompagnent de fuites de masse, mais la plupart sont rattrapés et tués. À l'intérieur même du ghetto de Kaunas (Kovno), une véritable guérilla permanente sévit contre les Allemands.
À Varsovie, les débats sont rudes entre ceux qui jugent toute résistance armée suicidaire, et ceux qui veulent témoigner au monde et à la postérité que les Juifs ne se sont pas laissés exterminer sans combat. Le 28 juillet 1942 est fondée l'organisation juive de combat qui, fait exceptionnel, parvient à regrouper aussi bien les sionistes que les communistes et les bundistes, seuls les sionistes «révisionnistes» (de droite) faisant encore bande à part.
Alors que sur plus de 500000habitants initiaux du ghetto, il n'en reste que moins de 90000 au printemps 1943, un millier de combattants sous les ordres du jeune et charismatique Mordechaj Anielewicz déclenchent le 19avril1943 le soulèvement du ghetto de Varsovie. Sans illusions sur la fin qui les attend tous, ils entendent explicitement démontrer à la postérité qu'une résistance juive a existé. De fait, à la grande fureur de Hitler lui-même, le ghetto insurgé parvient à tenir au moins cinq semaines contre les SS du général Jürgen Stroop. Malgré ses moyens dérisoires, il n'est submergé qu'après une lutte acharnée, là où des États européens entiers avaient capitulé sans combat ou avaient combattu moins longtemps.
Des révoltes armées ont aussi eu lieu en 1943 dans les ghettos de Sosnowiec, Bialystok, Czenstochow, Tarnow, Vilnius. Le Chant de Vilnius du poète yiddish et chef partisan Aba Kovner est resté l'hymne des résistants juifs de la Shoah.
Les révoltes les plus improbables et les plus spectaculaires ont eu lieu au cœur même des camps d'extermination. Le 2août1943, les détenus de Treblinka se soulèvent et une partie parvient à s'enfuir. L'épisode accélère la décision de démanteler ce centre de mise à mort. L'événement se reproduit le 14 octobre 1943 à Sobibor, théâtre d'une révolte remarquablement bien préparée, synchronisée à travers tout le camp. À Auschwitz-Birkenau, le 7 octobre 1944, les détenus du Sonderkommando chargés d'incinérer les gazés parviennent à dynamiter le Krematorium noIV et abattent quelques gardiens avant d'être tous tués.
Source : article : Shoah