LA LIBÉRATION DES CAMPS
La fin des camps
Enserrés dans un étau par suite de la progression des troupes alliées, les nazis s'efforçaient, chaque fois qu'ils le pouvaient, d'évacuer les camps, après avoir liquidé les malades et les détenus trop faibles pour marcher. Le massacre continuait tout au long de la route, selon les directives précises d'extermination venues de Berlin et que le Reichsfürher Himmler éprouvait encore le besoin de rappeler le 24 avril 1941, dans une note adressée à tous les commandants des camps qui n'étaient pas encore libérés : «Aucun détenu ne doit tomber vivant entre les mains de l'ennemi.»

Les Britanniques libèrent le camp de Bergen-Belsen. Bergen-Belsen réunissait toutes les « activités » qui avaient lieu dans un camp d’extermination, et ses résultats en terme de morts, de maladie et de malnutrition.
Lorsque les
survivants des camps furent libérés, à la joie se mêla l'immense
tristesse de n'avoir pu sauver à temps d'innombrables victimes, tous ces
déportés qui succombèrent aux maladies, à l'épuisement physique, à la
famine et au désespoir, ou furent assassinées par leurs bourreaux
jusqu'au dernier instant. L'étendue de cette catastrophe humaine reste
aujourd'hui encore difficile à chiffrer avec exactitude.
Le 22 juillet 1944 marque le début de la fin des camps de la mort nazis,
lorsque des unités soviétiques atteignirent le camp de concentration et
d'extermination de Majdanek, situé à l'est de la ville de Lublin. Dès le
mois de juin, Heinrich Himmler avait ordonné l'évacuation des camps
avant l'arrivée des Alliés et le transfert des détenus vers d'autres
camps. Cet ordre concernait en premier lieu les camps situés dans les
pays baltes, ainsi que celui de Majdanek où entre 200 000 et 250 000
personnes furent assassinées à compter de l'automne 1941 (1). Il fut le
premier camp à être évacué avant l'arrivée des libérateurs ; un millier
de détenus y fut toutefois abandonné. Avant de prendre la fuite, les
Allemands avaient tenté en vain d'effacer les traces de leurs crimes.
Les efforts entrepris par les autorités soviétiques pour informer
l'opinion publique à travers le monde entier des crimes qui se
révélèrent alors à eux ne trouvèrent à cette époque aucun écho.
La dissolution progressive du complexe de camps d'Auschwitz-Birkenau
débuta au cours de l'été 1944. Jusqu'à la fin de cette année-là, environ
la moitié des 155 000 détenus fut transférée en train, en camions ou à
pied vers les camps situés à l'Ouest. En novembre 1944, les usines
d'extermination d'Auschwitz cessèrent de fonctionner sur ordre de
Himmler (2).
Après le débarquement des Alliés en France, l'évacuation de
Natzweiler-Struthof, l'unique camp de concentration situé sur le sol
français (en Alsace annexée), commença en septembre 1944, ainsi que
celle de Herzogenbusch aux Pays-Bas. Les détenus de ce camp furent
transférés vers Sachsenhausen et Ravensbrück, ceux de Natzweiler dans
ses camps annexes, vers Dachau et d'autres camps.
Fin 1944, début
1945, l'Europe n'était plus qu'un vaste champ de ruines, la sphère de
puissance allemande était réduite à un étroit corridor en Europe
centrale. Toutefois, en janvier 1945, dans 24 camps principaux et
environ 1 200 camps annexes étaient encore détenus 700 000 personnes,
dont plus de 200 000 femmes, sous le commandement des SS (3). Les
estimations sur le pourcentage des déportés qui trouvèrent la mort
jusqu'au 8 mai 1945 oscillent entre 25 et 50%.
Le 27 janvier 1945, des unités de l'Armée rouge atteignirent
Auschwitz-Birkenau, situé au sud de la ville de Cracovie. Elles
libérèrent les quelque 7 000 malades et mourants qui y avaient été
abandonnés. Nombre d'entre eux succombèrent, à bout de forces, quelques
heures ou jours plus tard. Dans son récit sur les derniers jours à
Auschwitz, l'écrivain italien Primo Levi décrit la situation qui régnait
à l'arrivée des libérateurs en ces termes : « Nous nous trouvions dans
un monde de morts et de larves. Autour de nous et en nous, toute trace
de civilisation, si minime soit-elle, avait disparu. L'oeuvre de
transformation des humains en simples animaux initiée par les Allemands
triomphants avait été accomplie par les Allemands vaincus » (4). Une
dizaine de jours auparavant, dès le 17 janvier 1945, les quelque 60 000
détenus encore aptes à marcher furent emmenés vers l'Ouest. On estime à
au moins 15 000 le nombre de ceux qui ne survécurent pas à cette «
évacuation ». (5)
Des milliers de déportés sont assassinés ou meurent d'épuisement
Les détenus des
deux autres camps de concentration situés sur le sol polonais,
Gross-Rosen et Stutthof, ainsi que de leurs camps annexes furent
également évacués au cours des mois d'hiver, avant l'arrivée des troupes
de l'Armée rouge. Des milliers d'entre eux furent assassinés en chemin
ou moururent de faim, de froid et d'épuisement. L'arrivée des convois de
masse transportant des malades et des personnes à bout de forces dans
les camps situés dans la région appelée « ancien Reich » aggrava
dramatiquement les conditions de vie qui y régnaient. La nourriture
insuffisante, les équipements d'hygiène inexistants et le manque de
soins médicaux entraînèrent des épidémies et une montée en flèche du
taux de mortalité dans l'ensemble des camps. La direction SS réagit par
des actions meurtrières pour réduire le nombre de détenus, et en
aménageant des zones de la mort et des camps pour grabataires dans
lesquels les prisonniers étaient livrés à eux-mêmes. (6)
Début avril 1945, les Alliés de l'Est comme de l'Ouest avaient effectué
une telle avancée que l'effondrement final de la domination
nationale-socialiste était imminent. Pour les déportés de Buchenwald,
Dora, Flossenbürg, Ravensbrück, Sachsenhausen, Bergen-Belsen,
Neuengamme, Dachau et Mauthausen ainsi que ceux de plusieurs centaines
de camps extérieurs, les dernières semaines devinrent une course contre
la mort.

Peu après la libération, des femmes rescapées des camps font la cuisine près de piles de cadavres. Bergen-Belsen, Allemagne, après le 15 avril 1945.
Bergen-Belsen se vit conférer une position particulière parmi les camps de concentration. Au printemps 1943, un « centre d'accueil » fut créé pour les détenus juifs qui avaient tout d'abord été exclus de la déportation vers les camps d'extermination. Ils n'étaient pas soumis au travail forcé et leurs conditions de vie étaient plus supportables que dans les autres camps. Ce n'est qu'au cours de la phase finale, lorsqu'à l'automne 1944 les convois de détenus arrivèrent à Bergen-Belsen en provenance des camps évacués, que ce centre devint très rapidement un lieu d'hécatombe. Les places d'hébergement, les équipements d'hygiène, les soins pour les malades étaient insuffisants et les mauvaises conditions d'alimentation empiraient de jour en jour.
Entre janvier 1945 et le 15 avril 1945, jour de la libération du camp par les soldats britanniques, entre 80 000 et 90 000 personnes furent transférées vers Bergen-Belsen dans une centaine de convois (7). Les victimes de maladies, notamment du typhus, de la famine et de l'épuisement se comptèrent par dizaines de milliers. Lorsque les Britanniques arrivèrent au camp le 15 avril, les soldats furent submergés par une vision dantesque : 10 000 cadavres, peut-être, non enterrés, gisaient encore là, à l'endroit où ils avaient trouvé la mort. L'apparence des vivants permettait à peine de les distinguer des morts. Le médecin militaire britannique H.L. Glyn-Hughes relata plus tard son arrivée à Bergen-Belsen : « L'état du camp était vraiment indescriptible ; aucun récit ni aucune photographie ne peut restituer ces visions d'horreur à l'extérieur des baraques, et les scènes effroyables que l'on découvrit à l'intérieur étaient bien pires encore. Partout dans le camp s'élevaient des amas de cadavres de hauteur différente, certains en dehors des clôtures de barbelés, d'autres à l'intérieur entre les baraques. Des corps humains gisaient partout dans les différentes sections du camp. Les fossés de canalisation étaient remplis de cadavres, et dans les baraques elles-mêmes, les morts étaient innombrables, certains pêle-mêle avec les vivants sur un châlit » (8). Même si, en effet, l'image ne peut traduire ce que ressentirent ces hommes, les clichés et les films réalisés par les correspondants militaires britanniques à Bergen-Belsen et par les reporters américains dans d'autres camps marquent aujourd'hui encore la vision de l'opinion internationale.
Lorsque la 6e
division blindée de l'armée américaine pénétra dans Buchenwald le 11
avril, les SS avaient pris la fuite abandonnant 21 000 personnes. Le 14
avril, le commandant de Flossenbürg avait reçu de Himmler l'ordre
suivant : « Il est hors de question de se rendre. Le camp doit être
évacué immédiatement. Aucun détenu ne doit tomber vivant entre les mains
de l'ennemi » (10). Hormis quelques-uns, les 45 000 détenus de
Flossenbürg furent emmenés à pied en direction du Sud, mais là aussi la
trace de milliers d'entre eux fut perdue sur les différents itinéraires
des marches de la mort. Le 23 avril, les libérateurs trouvèrent quelque
1 600 survivants à Flossenbürg.
Neuengamme, faubourg de Hambourg, avait été entièrement évacué avant
l'arrivée des troupes britanniques. Les 10 000 derniers détenus avaient
été emmenés par les SS à la mi-avril à Lübeck et embarqués à bord de
trois navires qui, pris pour des transporteurs de troupes, furent
bombardés par des avions britanniques. 7 000 déportés périrent brûlés,
noyés ou abattus en tentant de regagner la rive à la nage.
Les camps de Sachsenhausen et de Ravensbrück, situés dans le Nord de
l'Allemagne, furent presque entièrement évacués avant la libération des
détenus par les troupes, à savoir, le 23 avril, 3 000 survivants à
Sachsenhausen et, le 28 avril, quelque 3 500 malades et enfants à
Ravensbrück. À leur arrivée à Dachau le 29 avril, les soldats américains
trouvèrent environ 30 000 détenus. L'« évacuation » débutée le 27 avril
avait été interrompue car les gardes SS avaient pris la fuite en
entendant se rapprocher les combats menés par les troupes américaines.
La libération du camp de Mauthausen le 5 mai ne mit pas seulement fin à
l'histoire de ce camp ouvert en 1938 et de ses camps annexes dans
lesquels périrent au moins 100 000 personnes. C'est l'ensemble de l'«
univers concentrationnaire », principal instrument de terreur de la
domination nationale-socialiste, qui cessa d'exister.
Dans tous les camps, malgré les efforts considérables pour prodiguer des
soins médicaux aux malades et procurer de la nourriture aux détenus
affamés, l'hécatombe se poursuivit encore après la libération. La
répression juridique immédiatement entreprise par les tribunaux
militaires alliés afin de punir les crimes commis ne trouva pas de
résonance positive parmi la population allemande. Plusieurs décennies
s'écoulèrent avant que le rejet des faits ne soit surmonté ne serait-ce
que partiellement, et qu'apparaissent un intérêt et une empathie envers
le sort des victimes. De nos jours, le témoignage des survivants
constitue la base essentielle pour que les nouvelles générations sachent
ce qu'était l'univers concentrationnaire jusqu'à la libération.
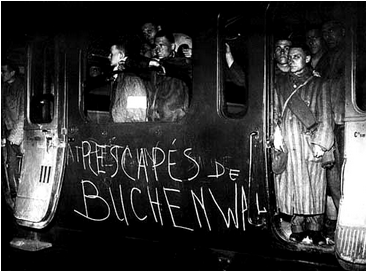
Retour vers la France de rescapés. Photo SGA/DMPA
L'évacuation et la libération des derniers camps
L'évacuation et la libération des derniers camps durèrent en tout un mois. Les troupes américaines furent les premières à atteindre, le 5 avril 1945, Ohrdruf, camp annexe de Buchenwald, situé près de Gotha, dans lequel les SS avaient massacré les détenus les jours précédents. Le camp de concentration de Buchenwald fut libéré le 11 avril. Son évacuation avait débuté le 7 avril. Sur les 47 500 détenus qui étaient alors internés dans le camp principal, 28 000 furent évacués en train ou à pied vers Flossenbürg, Dachau et Theresienstadt. Au cours de cette « évacuation », des milliers moururent d'épuisement ou abattus par les gardes SS qui les accompagnaient. (9)
Notes :
(1) Jozef
Marszalek, Majdanek, Lublin, Varsovie, 1984.
(2) Andrzej Strzelecki, Evakuierung, Auflösung und Befreiung des KL
Auschwitz, dans : Auschwitz, Nationalsozialistisches Vernichtungslager,
Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, 1997, p. 39.
(3) Bundesarchiv Berlin NS/439. Liste datant de janvier 1945 recensant
les données chiffrées sur les gardiens et les détenus dans les camps de
concentration.
(4) Primo Levi, Si c'est un homme, Francfort, 1961, p. 178.
(5) Andzej Strzelecki, a.O.
(6) voir Jens-Christian Wagner, Gesteuertes Sterben. Die Boelcke-Kaserne
als zentrales Siechenlager des KZ-Mittelbau, dans : Dachauer Hefte,
20/2004, p. 127-139 ; Verena Walter, Das Mädchenkonzentrationslager
Uckermark als Sterbe- und Selektionslager, dans : Dachauer Hefte,
20/2004, p. 157-166; Carina Baganz, Wöbbelin : Das letzte Aussenlager
des KZ Neuengamme als Evakuierungs- und Sterbelager, dans : Dachauer
Hefte, 20/2004, p. 166-179.
(7) Thomas Rahe, Das Evakuierungslager Bergen-Belsen, dans : Dachauer
Hefte, 20/2004, p. 49.
(8) Trial of Josef Kramer and Forty-Four Others (The Belsen Trial) éd.
par Raymond Phillips, London 1949, p. 31 cité d'après : Thomas Rahe,
Befreiung und Tod: Zeichnungen von Kriegskorrespondenten aus
Bergen-Belsen April-Juni 1945, dans: Beiträge zur Geschichte der
nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland, 2/19995, p. 116.
(9) Harry Stein, Konzentrationslager Buchenwald 1937-1945, Begleitband
zur ständigen historischen Ausstellung, Göttingen 1999, p. 227-238.
(10) Stanislav Zamecnik, Kein Häftling darf lebend in die Hände des
Feindes fallen. Zur Existenz des Himmler-Befehls vom 14./18. April 1945,
dans : Dachauer Hefte 1/1985, p .219-231.
Source : Dr Barbara Distel, Directrice du Mémorial de Dachau. Revue Les Chemins de la Mémoire n° 149 ¿ Avril 2005 pour Mindef/SGA/DMPA
LA LIBÉRATION D'AUSCHWITZ VUE PAR UN OFFICIER SOVIÉTIQUE
Commandant de la 107e division d'artillerie, j'ai entendu parler de ce camp pour la première fois au téléphone, le 26 janvier, alors que je dirigeais les combats pour libérer Neuberun. J'avais été appelé par le commandant du 106e corps d'artillerie, le général P.F Ilinyk, pour m'annoncer que les 100e et 322e divisions, en combattant pour libérer Monowica et Zarki, avaient établi qu'il s'agissait de parties d'un grand camp de concentration hitlérien dont le centre se trouvait à Auschwitz. Le commandant du corps m'a prévenu que nous allions non seulement devoir prendre Neuberun le plus vite possible, mais également tout faire pour empêcher l'adversaire de partir vers Auschwitz. Il a ordonné qu'après la prise de Neuberun, ma 107e division et la 148e division de fusiliers voisine continuent énergiquement leur offensive le long de la rive gauche de la Vistule, en menaçant par l'arrière la garnison adverse d'Auschwitz.
Les hitlériens ont résisté avec la dernière énergie. Nos pertes -les hommes morts- se montèrent à 180 personnes. La ville fut totalement libérée le 28 janvier et notre division se prépara à traverser la Vistule. Il y avait environ un kilomètre et demi jusqu'à Auschwitz, qui se trouvait sur la rive droite. Le général F. Krasavine, le commandant de la 100e division qui avait pris Auschwitz la veille, m'a appelé et m'a demandé de venir. J'ai prévenu mon adjoint et le chef d'état-major que je devais m'éloigner pour une heure et demie -deux heures et je suis parti pour Auschwitz. Il y avait en ville l'un des régiments de la division de Krasavine mais, lui, je ne l'ai pas vu.
On m'a amené sur le territoire du camp. Il tombait une légère neige, qui fondait immédiatement. Je me souviens que je portais un demi-manteau ouvert. Il commençait à faire sombre, mais nos soldats ont trouvé un appareil et on fait de la lumière. Des détenus émaciés, en vêtements rayés, s'approchaient de nous et nous parlaient dans différentes langues. Même si j'avais vu bien des fois des hommes mourir au front, j'ai été frappé par ces prisonniers transformés par la cruauté jamais vue des nazis en véritables squelettes vivants.
J'avais bien lu des tracts sur le traitement des Juifs par les nazis, mais on n'y disait rien de l'extermination des enfants, des femmes et des vieillards. Ce n'est qu'à Auschwitz que j'ai appris le destin des Juifs d'Europe. C'était le 29 janvier 1945.
J'ai été accueilli par le chef d'état-major du régiment, le colonel Degtiariov. Il m'a annoncé que la veille, on avait enterré soixante-dix-huit de nos morts, soldats et officiers.
Les déportés se déplaçaient sur le territoire du camp en combinaison à rayures. Deux d'entre eux se sont arrêtés, se sont mis à sourire et à battre des mains en regardant mon étoile de héros de l'Union soviétique.
«Alors vous êtes heureux d'être enfin libres ? où allez-vous ? Qui êtes-vous ? » leur demandai-je. Ils venaient de Belgique. J'ai noté leurs noms. Je me souviens également de deux femmes. Elle se sont approchées de moi, m'ont embrassé. Ces gens pouvaient encore sourire, mais il y en avait qui ne pouvaient plus que tenir debout en silence : des squelettes vivants, pas des hommes.
A Auschwitz, on m'a montré la baraque des femmes, séparée des autres. Sur le sol, il y avait du sang, des excréments, des cadavres : un terrible tableau. Il était impossible d'y rester plus de cinq minutes, à cause de l'horrible odeur des corps en décomposition. debout près des portes, j'ai dit : « Oui, il est impossible de rester longtemps ici.»
Source : Général Petrenko. Avant et après Auschwitz, p.144-146. © Flammarion, 2002.

Début des marches de la mort au cours desquelles les Juifs et les Polonais survivants sont évacués des camps. Des milliers de personnes trop faibles seront abattues en cours de route. A Palmnicken, 9 000 personnes sont amenées au bord de la mer baltique ou elles sont abattues ou précipitées sur les rochers où elles trouvent la mort.
Lors de leurs offensives contre l’Allemagne, les troupes alliées commencèrent à libérer des camps de concentration. Il y restait des survivants ; beaucoup d’entre eux avaient survécu à des marches de la mort.
Le premier grand camp nazi à être libéré fut Majdanek, près de Lublin, en Pologne, en juillet 1944. Surpris par la rapidité de l’avance soviétique, les Allemands tentèrent de dissimuler les preuves du meurtre de masse, en démolissant les infrastructures d'assassinat. Ils mirent le feu au four crématoire principal mais, dans la hâte de l’évacuation, ils n’eurent pas le temps de détruire les chambres à gaz. Durant l’été 1944, les Soviétiques parvinrent également sur les sites des camps d’extermination de Belzec, Sobibor et Treblinka. Les Allemands avaient démantelé ces camps en 1943, après y avoir exterminé une grande partie des Juifs de Pologne.
L'Armée rouge libéra Auschwitz, le plus grand camp d’extermination et de concentration, le 26 janvier 1945. Les Nazis avaient emmené la majorité des détenus dans des marches de la mort, et, quand ils pénétrèrent dans le camp, les soldats soviétiques ne trouvèrent que quelques milliers de prisonniers. De nombreuses preuves du meurtre de masse existaient encore à Auschwitz. Avant de fuir, les Allemands avaient détruit la plupart des entrepôts du camp, mais dans ceux qui restaient les Soviétiques trouvèrent les effets personnels des victimes. Ils découvrirent, par exemple, des centaines de milliers de costumes d’homme, plus de 800 000 vêtements de femme, et plus de 7 000 kg de cheveux humains. Mais les Nazis avaient fait sauter les fours crématoires.
Dans les mois qui suivirent, les Soviétiques libérèrent d’autres camps dans les pays baltes et en Pologne. Peu avant la capitulation allemande, les troupes soviétiques libérèrent les camps principaux de Stutthof, de Sachsenhausen et de Ravensbrück.
Le 11 avril 1945, Les troupes américaines libérèrent le camp de concentration de Buchenwald, situé près de Weimar, en Allemagne, quelques jours après qu'il ait été évacué par les Allemands. Le jour de la libération, une organisation de résistance clandestine de prisonniers prit le contrôle de Buchenwald pour empêcher les gardes du camp de commettre des atrocités. Les troupes américaines libérèrent plus de 20 000 prisonniers à Buchenwald. Elles libérèrent également les camps principaux de Dora-Mittelbau, de Flossenbürg, de Dachau et de Mauthausen.
Les troupes britanniques libérèrent des camps en Allemagne du Nord, parmi lesquels ceux de Neuengamme et de Bergen-Belsen. Elles pénétrèrent dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, près de Celle, à la mi-avril 1945. Quelque 60000 détenus, la plupart dans des conditions critiques à cause d’une épidémie de typhus qui y sévissait, y furent découverts vivants. Plus de 10 000 moururent des effets de la malnutrition et de maladies dans les semaines qui suivirent leur libération.
Les libérateurs découvrirent dans les camps, des cadavres qui s’amoncelaient en plein air. Ce n’est qu’après la libération des camps nazis que l’étendue des horreurs nazies apparut pleinement. Les détenus qui avaient survécu, exténués par le travail forcé et le manque de nourriture, avaient l’aspect de squelettes. Nombre d’entre eux étaient si affaiblis qu’ils pouvaient à peine bouger. Le danger de maladies était partout présent et de nombreuses baraques durent être brûlés pour prévenir la diffusion d’épidémies. Pour les survivants, le retour à la normalité s’annonçait long et difficile.
Source : Mémorial de la Shoah, Paris, France.

Peu après leur libération, des survivants des camps, internés au “Block des enfants 66” de Buchenwald - une baraque spéciale pour enfants. Allemagne, après le 11 avril 1945.

Peu après la libération, des enfants rescapés du camp d’Auschwitz sortent des baraques pour enfants. Pologne, après le 27 janvier 1945. United States Holocaust Memorial Museum
En 1947, Primo Levi, écrivait dans sa préface de l'ouvrage-témoignage Si c'est un homme J'ai eu de la chance de n'être déporté à Auschwitz qu'en 1944, alors que le gouvernement allemand, en raison de la pénurie croissante de main-d'oeuvre, avait déjà décidé d'allonger la moyenne de vie des prisonniers à éliminer ; améliorant sensiblement leurs conditions de vie et suspendant provisoirement les exécutions arbitraires individuelles.
Aussi, en fait de détails atroces, mon livre n'ajoutera-t-il rien à ce que les lecteurs du monde entier savent déjà sur l'inquiétante question des camps d'extermination. Je ne l'ai pas écrit dans le but d'avancer de nouveaux chefs d'accusation, mais plutôt pour fournir des documents à une étude dépassionnée de certains aspects de l'âme humaine. Beaucoup d'entre nous, individus ou peuples, sont à la merci de cette idée, consciente ou inconsciente, que «l'étranger, c'est l'ennemi». Le plus souvent, cette conviction sommeille dans les esprits, comme une infection latente ; elle ne se manifeste que par des actes isolés, sans liens entre eux, elle ne fonde pas un système. Mais lorsque cela se produit, lorsque le dogme informulé est promu au rang de prémisse majeure d'un syllogisme, alors, au bout de la chaîne logique, il y a le Lager ; c'est-à-dire le produit d'une conception du monde poussée à ses plus extrêmes conséquences avec une cohérence rigoureuse ; tant que la conception a cours, les conséquences nous menacent. Puisse l'histoire des camps d'extermination retentir pour tous comme un sinistre signal d'alarme.
Malade, épuisé par un an d'internement, il assiste à la fuite des SS, qui abandonnent le camp d'Auschwitz dès les premiers bombardements et redoutent l'avance des troupes soviétiques.
Il écrit :
-Vous ne savez pas ? leur dis-je, demain on évacue le camp.
Ils m'accablèrent de questions :
- Où ça ? A pied ?... Même les malades ? Mêmes ceux qui ne peuvent pas marcher ?
ils savaient que j'étais un ancien du camp et que je comprenais l'allemand, et ils en concluaient que j'en savais là-dessus beaucoup plus que je ne voulais l'admettre.
Je ne savais rien d'autre ; je le leur dis, mais ils n'en continuèrent pas moins à me questionner. Quelle barbe ! Mais c'est qu'ils venaient d'arriver au Lager, ils n'avaient pas encore appris qu'au Lager on ne pose pas de questions.
Dans l'après-midi, le médecin grec vint nous rendre visite. Il annonça que même parmi les malades, tous ceux qui étaient en état de marcher recevraient des souliers et des vêtements, et partiraient le lendemain avec les bien-portants pour une marche de vingt kilomètres. Les autres resteraient au K.B., confiés à un personnel d'assistance choisi parmi les malades les moins gravement atteints.
Le médecin manifestait une hilarité insolite, il avait l'air ivre. Je le connaissais, c'était un homme cultivé, intelligent, égoïste et calculateur. Il ajouta qu'on distribuerait à tout le monde, sans distinction, une triple ration de pain, ce qui mit en joie les malades. Quelques uns voulurent savoir ce qu'on allait faire de nous. Il répondit que probablement les Allemands nous abandonneraient à nous-mêmes : non, il ne pensait pas qu'ils nous tueraient. Il ne faisait pas grand effort pour cacher qu'il pensait le contraire, sa gaieté même était significative.
Il était déjà équipé pour la marche ; dès qu'il fut sorti, les deux jeunes Hongrois se mirent à parler entre eux avec animation. Leur période de convalescence était presque achevée, mais ils étaient encore très faibles. On voyait qu'ils avaient peur de rester avec les malades et qu'ils projetaient de partir avec les autres. Il ne s'agissait pas d'un raisonnement de leur part : moi aussi, probablement, si je ne m'étais pas senti aussi faible, j'aurai obéi à l'instinct grégaire ; la terreur est éminemment contagieuse, et l'individu terrorisé cherche avant tout à fuir.
A travers les murs de la baraque, on percevait dans le camp une agitation insolite. l'un des deux Hongrois se leva, sortit et revint une demi-heure après avec un chargement de nippes immondes, qu'il avait dû récupérer au magasin des effets destinés à la désinfection. Imité de son compagnon, il s'habilla fébrilement, enfilant ces loques les unes sur les autres. On voyait qu'ils avaient hâte de se trouver devant le fait accompli, avant que la peur ne les fit reculer.
Ils étaient fous de s'imaginer qu'ils allaient pouvoir marcher, ne fût-ce qu'une heure, faibles comme ils étaient, et qui plus est dans la neige, avec ces souliers percés trouvés au dernier moment. J'essayai de le leur faire comprendre, mais ils me regardèrent sans répondre. Ils avaient des yeux de bête traquée.
L'espace d'un court instant, l'idée m'effleura qu'ils pouvaient bien avoir raison. Ils sortirent par la fenêtre avec des gestes embarrassés, et je les vis, paquets informes, s'éloigner dans la nuit d'un pas mal assuré. Ils ne sont pas revenus ; j'ai su beaucoup plus tard que, ne pouvant plus suivre, ils avaient été abattus par les SS au bout des premières heures de route. [...]
Finalement, ce
fut le tour d'Alberto, venu me dire au revoir par la fenêtre, au
mépris de l'interdiction. Nous étions devenus des inséparables : « les
deux Italiens», comme nous appelaient nos camarades étrangers qui, le
plus souvent, confondaient nos prénoms. Depuis six mois nous
partagions la même couchette et chaque grammes d'extra «organisé» par
nos soins ; mais Alberto avait eu la scarlatine quand il était enfant,
et moi je n'avais pu le contaminer. Il partit donc, et je restai. Nous
nous dîmes au revoir en peu de mots : nous nous étions déjà dit tant
de fois tout ce que nous avions à nous dire... Nous ne pensions pas
rester séparés bien longtemps. Il avait trouvé de gros souliers de
cuir, en assez bon état : il était de ceux qui trouvent immédiatement
tout ce dont ils ont besoin.
Lui aussi était joyeux et confiant, comme tous ceux qui partaient. Et
c'était compréhensible : on s'attendait à quelque chose de grand et de
nouveau ; on sentait finalement autour de soi une force qui n'était
pas celle de l'Allemagne, on sentait matériellement craquer de toutes
parts ce monde maudit qui avait été le nôtre. Ou du moins tel était le
sentiment des bien-portants qui, malgré la fatigue et la faim, étaient
encore capables de se mouvoir ; mais il est indéniable qu'un homme
épuisé, nu ou sans chaussures, pense et sent différemment : et ce qui
dominait alors dans nos esprits, c'était la sensation paralysante
d'être totalement vulnérables et à la merci du destin.
Tous les hommes valides (à l'exception de quelques individus bien conseillés qui, au dernier moment, s'étaient déshabillés et glissés dans les couchettes d'infirmerie) partirent dans la nuit du 17 janvier 1945. Vingt mille hommes environ, provenant de différents camps. Presque tous disparurent durant la marche d'évacuation : Alberto est de ceux-là. Quelqu'un écrira peut-être un jour leur histoire.
Nous restâmes donc sur nos grabats, seuls avec nos maladies et notre apathie plus forte que la peur.
Dans tout le K.B., nous étions peut-être huit cents. Dans notre chambre, nous n'étions plus que onze, installés chacun dans une couchette, sauf Charles et Arthur qui dormaient ensemble. Au moment où la grande machine du Lager s'éteignait définitivement, commençaient pour nous dix jours hors du monde et hors du temps.
Source : Si c'est un homme. Primo Levi. Presses Pocket. 1988.
LES DERNIERS JOURS DE LA SHOAH
En janvier 1945, les Soviétiques lancèrent une offensive générale contre les armées allemandes qui se trouvaient en Pologne et dans le reste de l'Europe orientale. Quelques 58 000 détenus du complexe concentrationnaire d'Auschwitz furent évacués par les nazis ; les autres, environ 7 000 personnes, furent libérées par les troupes soviétiques le 27 janvier. A partir de ce moment, et suivant ce qui fut sans doute une directive orale de Hitler, les détenus juifs et non juifs des camps qui étaient sur le point d'être libérés furent acheminés vers la zone toujours contrôlée par les nazis, qui se réduisait de jour en jour.
L'idée était que les ennemis du Reich ne devaient pas tomber vivants aux mains des Alliés. Officiellement, il y avait environ 714 000 prisonniers, hommes et femmes, dans les camps nazis en janvier 1945, mais le nombre réel était sans doute proche d'un million. On estime qu'environ 40% d'entre eux étaient juifs, mais on ne possède aucune source documentaire fiable. Les détenus furent convoyés à pied ou en wagons à bestiaux ouverts, avec peu, voire pas, d'eau ni de nourriture, en plein hiver. Ils furent nombreux à succomber ainsi. Ceux qui avaient du mal à suivre la cadence de la marche étaient abattus. Les itinéraires étaient prolongés artificiellement pour qu'un maximum de détenus meurent en route. Les Juifs étaient encore plus maltraités que les autres. On estime que 40 % à 60% de Juifs périrent. Des conditions de plus en plus chaotiques, l'absence de directives précises, firent que les commandants sur le terrain étaient les maîtres absolus du destin de tous.
Les détenus qui parvenaient enfin aux camps qui étaient encore sous contrôle nazi furent entassés dans des baraquements déjà surpeuplés ; les réserves d'eau et de nourriture s'épuisant, la famine et les épidémies firent des ravages. Le cauchemar ultime, pour cette époque, fut celui que vécurent les détenus de Bergen-Belsen, que l'Armée britannique, libéra le 14 avril 1945. Il est impossible d'affirmer que c'était là un prolongement programmé de la Solution finale, mais le désir de voir survivre aussi peu de Juifs que possible fait de ces derniers mois un épisode du génocide juif.
Source : Yehuda Bauer. Le livre noir de l'humanité. Encyclopédie mondiale des génocides. Éditions Privat. 2001.