POGROM EN JUILLET 1942 DANS LE GHETTO DE MINSK EN BIELORUSSIE
 Voici la description du pogrom que donne Lilia Samoïlovna Gleizer, qui
l'a vécu de la première à la dernière heure.
Voici la description du pogrom que donne Lilia Samoïlovna Gleizer, qui
l'a vécu de la première à la dernière heure.
"A midi on amena sur la place du jubilé tous ceux qui se trouvaient dans l'enceinte du ghetto. On installa sur la place d'énormes tables décorées comme pour une fête, chargées de toutes sortes de victuailles et de vins, où s'installèrent les organisateurs d'un massacre encore jamais vu dans l'histoire.
Au centre était assis le chef du ghetto, Richter, décoré par Hitler de la croix de Fer. A côté de lui se trouvait un officier SS aux mâchoires proéminentes Räde, un des chefs du ghetto, et un homme gros et gras, le major Benzke, chef de la police de Minsk. [Non loin de ce trône diabolique se dressait une tribune spécialement construite pour l'occasion. Les fascistes obligèrent le compositeur Joffé, membre du Conseil juif du ghetto, à monter à cette tribune et à prendre la parole. Trompé par Richter, Joffé commença par tranquilliser la foule angoissée, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un enregistrement des habitants et d'un échange des bandes de tissu. A peine Joffé avait-il terminé son discours rassurant que] de toutes parts arrivèrent sur la place les camions de la mort. [Joffé comprit tout de suite ce que cela signifiait, et il cria à la foule bouleversée qui répétait ces mots terrifiants, "les camions de la mort" : " Camarades ! On m'a trompé. On va vous tuer. C'est un pogrom !"]
La foule affolée se rua de tous côtés, cherchant à échapper à une mort horrible. C'était la confusion totale, les gens ne savaient plus où aller, une multitude d'étoiles jaunes à six branches passait devant les yeux. Les fascistes qui avaient déjà encerclé la place, ouvrirent un feu nourri sur la foule sans défense. Mais les gens se jetaient en avant en dépit de tout, ils se battaient à mains nues avec les fascistes armés jusqu'aux dents. Beaucoup de ceux-ci durent faire marche arrière jusqu'à ce que la foule fût calmée. Toute la place était jonchée de cadavres et couverte de sang.
Les Allemands alignèrent des files interminables de femmes et de vieillards que la fusillade avait rendus silencieux, devant les dix camions. Les enfants furent séparés des adultes et on les fit mettre à genoux, les bras en l'air. Les petits enfants, épuisés et faibles, se mirent à pleurer : leurs petits bras se fatiguaient et retombaient tout de suite. Pour la peine, on les leur coupait avec des poignards, ou bien on leur rompait la colonne vertébrale, ou bien encore, élevant l'enfant au-dessus de sa tête, le fasciste le jetait de toutes ses forces sur la chaussée pavée : après un tel choc la cervelle de l'enfant jaillissait de son crâne éclaté. Les mères qui se tenaient dans la file devant les camions à gaz perdaient aussitôt l'esprit en voyant cela, elles se jetaient comme des tigresses en furie sur les Allemands et étaient abattues d'une rafale de fusil-mitrailleur. Ceux qui refusaient de monter dans les camions connaissaient une mort horrible. On les traînait vers les tables où, accompagnés par les accordéons, les convives prononçaient des discours d'ivrognes. Hattenbach, Richter, Räde et les autres, complètement soûls, annonçaient les sentences : "Couper le nez et les oreilles, tuer à coups de poing ou à coups de fouet", etc. Celle-ci était, aussitôt exécutée, soit par les juges eux-mêmes, soit par les policiers, les agents de la Gestapo ou les soldats de la garnison.
[Zorov, artiste émérite de la république, en voyant ce spectacle sanglant, se jeta sur les fascistes en les maudissant. Il se mit à les mordre, à leur donner des coups de poing et des coups de pied. Il fut attaché et jeté sans connaissance dans le camion.]
Cela continua ainsi jusqu'au soir tard. La place se vida, les organisateurs des massacres s'endormirent à la table de fête. Le pogrom ralentit. Seuls, les soldats de la garnison de Minsk, qui participaient systématiquement à toutes les expéditions punitives dans le ghetto, traînaient à la recherche d'objets de valeur. Tous les enfants qu'on avait fait mettre les mains en l'air avaient été tués jusqu'au dernier. Les camions ne revenaient plus. Ils avaient emmené à Trostianetz ou à Toutchinka tous ceux qui n'avaient pas été massacrés sur place.
La nuit, il fut ordonné aux membres de la police juive encore en vie de nettoyer la place des cadavres et du sang. Au matin du lendemain, l'ordre avait été exécuté. L'aube du 29 juillet se leva. La journée était maussade, comme si la nature pressentait la poursuite du massacre. Un soleil voilé se montrait par instants, et il se cachait aussitôt dans des nuées noires d'orage. Le ghetto était désert.
A dix heures du matin, on entendit sur la place du Jubilé le ronronnement des voitures allemandes. Un groupe de soldats de la garnison de Minsk placé sous le commandement d'un officier allemand, le Major Benzke, chef de la police, connu comme un bourreau, repartirent pour piller les maisons et débusquer les planques. Les tables du festin furent enlevées, car la pluie menaçait, et emportées dans le bâtiment qui abritait le Comité. C'est là également qu'on amena pour les châtier les vieillards, les femmes et les enfants trouvés dans les planques, qui avaient étés découvertes en grand nombre ce jour là.
Entrés de force dans l'hôpital du ghetto qui n'avait pas été touché le premier jour du pogrom, les Allemands et la police assassinèrent à coups de poignard les malades et le personnel médical.
Le 1er août après quatre jours de massacres, les Allemands traînèrent à nouveau sur la place du Jubilé la table chargée de victuailles et de vin, où s'installèrent les mêmes chefs.
Il fut ordonné à la Gestapo et aux policiers de retrouver coûte que coûte les derniers habitants du ghetto qui se cachaient dans les planques.
Ce dernier jour du pogrom, les fascistes franchirent toutes les bornes de l'imagination humaine en matière de crime. Sous les yeux des mères qui perdaient l'esprit, qui tombaient évanouies, les Allemands ivres et les policiers violaient les jeunes filles, sans que le regard de leurs camarades ou de l'entourage les gêne le moins du monde, leur tranchaient les organes sexuels avec leurs poignards, plaçaient les corps vivants et morts dans les poses les plus obscènes, coupaient des nez, des seins, des oreilles.
Les mères se jetaient avec furie sur les fascistes et tombaient mortes, la tête écrasée.
Des vieillards impotents étaient tués d'un coup de matraque en caoutchouc sur la tête, ou battus à mort avec des fouets de cuir. Toute la journée retentirent sans arrêt les cris hystériques, les sanglots et les malédictions que des dizaines d'accordéons ne parvenaient pas à couvrir. A trois heures de l'après-midi, tout était fini. Une heure plus tard, les aides de Richter quittaient le ghetto." (1)
Extrait de l'ouvrage "Le livre noir". Sur l'extermination scélérate des Juifs par les envahisseurs fascistes allemands dans les régions provisoirement occupées de l'URSS et dans les camps d'extermination en Pologne pendant la guerre de 1941-1945. Actes Sud, 1995.
LES POGROMS DANS L' HISTOIRE
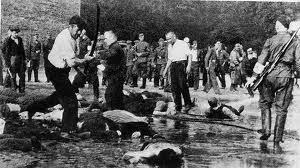
Le mot Pogrom est d'origine russe, il signifie "attaques", ou "émeute". Il désigne un assaut, avec pillages et meurtres, d'une partie de la population contre une autre. Plus précisément, les connotations historiques se rapportent aux attaques violentes qui ont été perpétrées par les populations locales contre les communautés juives au sein de l'Empire russe et ceci dès les années 1980.
Ces massacres qui s'appuyaient à la fois sur un fort ressentiment économique et politique, associées à un antisémitisme religieux traditionnel, se déchaînèrent avec l'assentiment voire l'organisation du gouvernement et de la police tsariste. Les victimes juives étaient violentées, tuées et leur propriété pillées. Ainsi, dans la Russie tsariste la population chrétienne fomente des vagues de pogroms de 1881 à 1917.

Cosaques mercenaires du Tsar Nicholas II après avoir participés au pogrom à Circa en 1909
"Le Tsar Alexandre III, qui succède à son père Alexandre II assassiné, met fin à la politique libérale de ce dernier. Conseillé par son ancien précepteur, Konstantin Pobedonostev, devenu procureur du Saint - Synode, il mène dès son avènement une politique réactionnaire et antisémite. Les Juifs sont rendus responsables de l'assassinat du tsar précédent. La politique du gouvernement au sujet des Juifs tient dans ce programme: «Un tiers des Juifs sera converti, un tiers émigrera, un tiers périra». En 1881 éclatent plus de cent pogroms: les principaux sont ceux d'Elisabethgrad le 15 avril 1881, de Kiev le 26 avril, d'Odessa du 3 au 5 mai 1880, de Varsovie, alors possession russe entre décembre 1881 et janvier 1882 et de Balta le 22 mars 1882. Les populations locales chrétiennes, soutenues et souvent incitées par la police du tsar, attaquent les communautés juives de la ville ou du village avec l'approbation des autorités civiles et religieuses. Aux destructions et pillages des biens des Juifs s'ajoutaient les viols et les assassinats. La troupe n'arrive souvent que trois jours après le début du pogrom. Le gouvernement russe utilise les pogroms pour limiter les droits économiques des Juifs et les expulser des villages.
Alors que la Russie traverse une grave crise révolutionnaire, une deuxième vague de pogroms frappe les populations juives entre 1903 et 1906. Les plus importants sont ceux de Kichinev le 6 avril 1903, de Jitomir en mai 1905 et de Bialystock le 1er juillet 1906. À Kichinev, où la presse et les autorités alimentent des rumeurs antisémites depuis plusieurs mois, c'est le meurtre d’un jeune chrétien, Michael Ribalenko, qui met le feu aux poudres. Accusés de crime rituel, les juifs subissent un pogrom de trois jours, le gouverneur ayant donné l'ordre à la police de ne pas intervenir. Après le pogrom d'avril 1903, les Juifs de Kichinev organisent des comités d'autodéfense. Cela n'empêche pas 19 d’entre eux de périr lors de nouvelles attaques des 19 et 20 octobre 1903.
Après la Révolution russe d'octobre 1917, les Juifs de Russie ont continué à être persécutés par les tsaristes et on compte des milliers de victimes de pogroms pendant la guerre civile de 1918 à 1921, en particulier des Juifs d'Ukraine et de Pologne orientale, certains les accusant d'être à l'origine du bolchevisme donc de la Révolution d'Octobre et parlent alors de judéo -bolchevisme. Des bandes de paysans en lutte contre l' Armée rouge massacrent les Juifs avec l'appui de certaines troupes ukrainiennes du président Simon Petlioura comme en particulier à Proskourov le 15 février 1919. Ce dernier sera assassiné à Paris en 1926 par Samuel Schwartzbard. En Russie même, l'Armée blanche de Denikine est à l'origine de plusieurs pogroms dont celui de Fastov le 15 septembre 1919. Pour l'année 1919, les historiens ont recensé 6000 morts dans les pogroms anti-juifs en Russie.
En tout, la Russie a été pendant cette période, le lieu de pogroms majeurs et 349 mineurs, qui auraient fait plus de 60000 morts. Les pogroms ont une double conséquence: l'émigration massive de 600000 Juifs au cours des vingt dernières années du XIXesiècle, vers les États-Unis essentiellement, et la création du mouvement sioniste.
Les pogroms pendant la Seconde Guerre mondiale

Lors de la déportation de ceux qui avaient survécu au pogrom de Iasi vers Calarasi ou Podul Iloaei, les Roumains arrêtent un train pour jeter les cadavres de ceux qui sont morts en route. Roumanie, juillet 1941.
Durant la Seconde guerre mondiale, dans le cadre de la Shoah, les nazis favorisent les pogroms en Union Soviétique. Les raisons qui poussent les Einsatzgruppen sont de plusieurs ordres. Les Einsatzgruppen ont reçu l'ordre de massacrer les populations juives d'Union Soviétique dans le cadre des opérations mobiles de tuerie accompagnant l'invasion de l'URSS. Pour eux, chaque Juif tué dans un pogrom est un Juif en moins à exécuter par leurs soins. Les Einsatzgruppen engagent ainsi leur responsabilité. L'armée allemande étant défavorable aux massacres. De plus, les Einsatzgruppen souhaitent que les populations locales prennent part aux pogroms pour des raisons de maintien de l'ordre, les pogroms sont perpétués dans les zones où l'armée allemande n'avait pas encore établi son autorité.
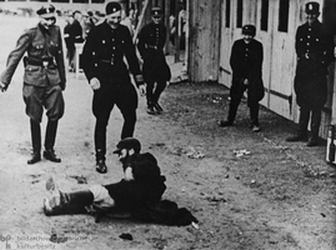
Les premiers pogroms ont lieu en Lituanie. Dès les premiers jours de l'attaque allemande, des groupes armés anti-communistes lituaniens, dirigés par Algirdas - Klimaitis, entrent en action contre l'arrière-garde communiste en pleine déroute. La police de sécurité allemande (Sicherheitsdienst ou SD) persuade alors Klimaitis de retourner ses troupes contre les Juifs. Le pogrom de Kaunas, alors capitale de la Lituanie, fait 3800 victimes. 1200 autres sont tués dans des localités environnantes. En Lettonie, le pogrom de Riga fait 400 victimes. L'Einsatzgruppe filme les pogroms à des fins de propagande. Après la dispersion des anti-communistes, les pays Baltes ne connaissent plus d'autres pogroms. Le 10 juillet 1941, à Jedwabne, au nord-est de la Pologne, 1600 juifs sont massacrés par la population locale devant les caméras allemandes qui filment la tuerie. Le pogrom ne laisse que 7 survivants parmi les Juifs.

Des civils ukrainiens frappent un Juif au cours d’un pogrom à Lvov. Pologne, du 30 juin au 3 juillet 1941.
En Galicie, à Lwow, en représailles à la déportation d'Ukrainiens par les Soviétiques, plus de 1000 juifs sont livrés à la SD. À Tarnapol , après la découverte de 3 cadavres allemands dans les prisons, 70 juifs sont tués à la dynamite par les Ukrainiens. Un peu plus à l'Est à Kremenets, en représailles à l'exécution de 150 Ukrainiens par les Soviétiques, 130 Juifs sont battus à mort par la population locale. Raul Hilberg précise que malgré leurs violences, les pogroms de Galicie n'ont pas fait autant de victimes que les Allemands le souhaitaient. La violence est à chaque fois inspirée voire organisée par les Einsatzgruppen, sauf à Jedwabne où l'initiative a directement été prise par les Polonais. Elle intervient toujours peu après leur arrivée. Elle ne s'étale pas dans la durée. De plus, les pogroms ont presque tous eu lieu dans les zones annexées par l'URSS en 1939 et 1940."(1)
(1) Article sur les pogroms.
LE POGROM OUBLIÉ
En 1941, dans le village de Jedwabne, 16 00 juifs furent sauvagement assassinés par leurs voisins. Aujourd'hui les langues se délient.
Ce jour-là, le 10 juillet 1941, il règne une chaleur suffocante. Sous un soleil de plomb, moins de deux semaines après l'invasion nazie du nord-est de la Pologne, les habitants du village de Jedwabne massacrent sous les yeux des soldats allemands environ 1 600 de leurs voisins juifs. Joseph Lewin est l'un des premiers à mourir, lapidé. Il avait 16 ans. Puis d'autres juifs sont tués à coups de massue. Deux forgerons sont noyés. Certains malheureux sont poignardés et laissés pour morts, le long des rues. D'autres ont la langue coupée et les yeux crevés (l'un des attaquants se vantera d'avoir tranché 18 gorges). Des bébés sont arrachés aux bras de leurs mères et piétinés à mort.
Un groupe de jeunes décapite Gitele Nadolnik, la jeune melamed (prof d'hébreu) ; ils donnent des coups de pied dans sa tête sanguinolente, comme dans un ballon de football. Le soir, tandis que le soleil s'approche de l'horizon, les Polonais placent un drapeau rouge dans les mains du rabbin, un papy de 90 ans. Couverts de sang, titubant de soif, les derniers juifs sont rassemblés sur la place du marché, devant l'église, et obligés de marcher en colonne par rangées de quatre, derrière le rabbin, en chantant : Nous, les juifs, sommes responsables de la guerre. Ils sont poussés dans une grange, à deux pas du cimetière juif, où, quelques heures plus tôt, ils ont creusé leur propre fosse commune. Les Polonais arrosent d'essence la grange, puis ils mettent le feu.
A toutes les portes, des guetteurs veillent, une hache à la main, afin que personne ne s'échappe. Comme des cris inhumains se font entendre, des musiciens du village entament une marche joyeuse pour couvrir les appels à l'aide. Mais, à quelques kilomètres de là, des paysans aperçoivent la colonne de fumée noire. Ils discernent des cris, aussi, «plus atroces que tout ce que j'avais entendu auparavant», confiera plus tard l'un d'eux. Courant à travers champs, 7 juifs survivront au pogrom. A la nuit tombée, des Polonais découvrent des petits enfants juifs qui avaient échappé à la rafle. Les gamins sont transpercés à coups de fourche puis jetés dans le brasier.
Durant plusieurs jours, l'air restera chargé d'une odeur de chair brûlée.
Voilà, en quelques lignes, le récit des événements. Les faits, les chiffres, les témoignages figurent dans le livre de Jan Tomasz Gross, Neighbours. Destruction of the Jewish Community in Jedwabne (1). Historien et sociologue d'origine juive polonaise, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, l'auteur est installé aux Etats-Unis depuis 1968 et professeur à l'université de New York.
Comment un massacre d'une telle ampleur et d'une telle portée historique a-t-il pu rester occulté pendant si longtemps? Car l'histoire était connue...
Dès 1945, Shmuel Wasserstein, l'un des survivants, raconte les événements en détail. Son témoignage est recueilli et déposé dans les archives de l'Institut historique juif, à Varsovie. En 1949, puis en 1953, les autorités (communistes) font inculper une vingtaine de villageois. Lors des procès, juifs et non-juifs se succèdent à la barre des témoins. Tous accusent leurs compatriotes, habitants de Jedwabne; les Allemands, quant à eux, se seraient contentés de filmer le pogrom. Parmi les accusés, un homme est condamné à mort, tandis que les autres écopent de simples peines de prison. Tous seront libérés, même le condamné à mort, et le tribunal, niant l'évidence, désigne les nazis comme les principaux responsables du massacre des juifs. Une pierre commémorative est alors érigée à Jedwabne, qui perpétue ce mensonge jusqu'à nos jours. Le gouvernement de Varsovie a demandé qu'elle soit ôtée il y a seulement quelques semaines.
En décembre 1966, un chercheur de l'Institut historique juif publie une étude sur les nombreuses tueries antijuives dans la région de Jedwabne, en 1941-1942. Par endroits, il fait allusion à l' «aide» fournie aux Allemands par la «population locale». En 1980, enfin, un livre - mémorial publié outre-Atlantique rassemble les souvenirs d'anciens juifs du village. «Malgré cet ensemble de documents et de témoignages directs, le massacre de Jedwabne n'est jamais entré dans l'ensemble des grands événements connus de la période», soupire Jan Tomasz Gross. Comment cela a-t-il été possible? « Il m'est très difficile de vous expliquer comment cet oubli collectif a pu se produire. Moi-même, je me souviens d'avoir lu un témoignage sur ce sujet il y a plusieurs années. Mais le récit me semblait tellement incroyable, au sens propre, que je ne l'avais pas pris au sérieux. Je me suis dit: Cet homme parle en 1945; il est traumatisé par ce qu'il a vécu et il divague. Il ne sait plus de quoi il parle. Le déclic s'est produit il y a trois ans environ, quand j'ai vu par hasard des extraits d'un documentaire télévisuel en cours de réalisation. A l'écran, une femme expliquait: Ils ont volé à mon père les clefs de sa grange. Que pouvait-il faire? Alors, soudain, j'ai compris que je devais aller sur place enquêter, retrouver les documents.»
Le maire actuel de Jedwabne, Stanislaw Maichalowski, 48 ans, a entendu parler de l'histoire pour la première fois quand il avait 8 ans, mais il n'y a jamais vraiment réfléchi. Et puis il a lu le livre de Gross. «Comprendre ce qui s'est passé ici, confie-t-il, c'est écrasant.» Ses administrés ne sont pas tous du même avis. L'édile reçoit lettres et coups de téléphone anonymes. Beaucoup d'habitants - et le curé du village - lui reprochent de parler aux journalistes. Le silence reste la règle, comme l'a constaté Anna Bikont, reporter au quotidien Gazeta Wyborcza: «J'ai rencontré plusieurs vieux Polonais qui m'ont expliqué comment, à l'époque, ils avaient protégé des juifs. Certains gardent des lettres de remerciements de familles rescapées; d'autres sont médaillés de tel ou tel centre israélien. Mais la plupart me demandent de taire leur nom. Ils craignent des ennuis avec leur entourage.»
Le livre de Gross est paru en Pologne au printemps 2000. Avec une honnêteté rare, l'historien a voulu qu'une année s'écoule entre la sortie de son ouvrage en Pologne et sa publication en Europe et aux Etats-Unis. «Je tenais à laisser du temps aux Polonais, explique Gross, afin qu'ils puissent en discuter entre eux. Qu'ils abordent enfin cette page noire - et ce n'est pas la seule - de leur histoire nationale.» Las! à l'exception de deux enquêtes parues dans le quotidien Rzeczpospolita, qui confirment les conclusions de l'ouvrage, aucun journal n'aborde le sujet. Depuis la fin de l'année dernière, en revanche, à l'approche de la publication du livre aux Etats-Unis, le débat ne cesse de prendre de l'importance. Toute information liée à Jedwabne fait la Une du journal télévisé. Contradictoires et ambiguës, les moindres déclarations de l'Eglise catholique sur le sujet sont analysées à la virgule près. A la faveur de ce débat, évidemment passionnel, le vrai procès de Jedwabne commence enfin. Les étrangers dénoncent sa lenteur, mais les Polonais eux-mêmes sont surpris de la rapidité avec laquelle certains tabous s'effondrent... L'un après l'autre, des épisodes peu glorieux de l'histoire nationale sont abordés dans les journaux.
Débarrassée du régime communiste et de son historiographie officielle et plus critique, aussi, envers l'Eglise, autrefois toute-puissante, la Pologne, longtemps perçue par ses habitants comme un vénérable «Christ parmi les nations», apprend à se regarder dans les yeux, quitte, parfois, à se faire peur. Ce courage-là est nouveau. Et c'est bien."
Marc Epstein, publié dans le journal "l'Express" le 12/04/2001.
(1) Publié ces jours-ci en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis (indisponible en français).
Des témoignages supplémentaires figurent dans un documentaire d'Agnieszka Arnold diffusé les 3 et 4 avril à la télévision polonaise.
LES POGROMS APRÈS LA GUERRE EN POLOGNE

Des personnes rassemblées autour d’une tranchée étroite pleurent leurs morts tandis que les cercueils des victimes du pogrom sont mis dans une fosse commune, après le service de cet enterrement de masse. Kielce, Pologne, après le 4 juillet 1946. Wide World Photo
Les pogroms après la guerre en Pologne
À partir du printemps 1946, les Juifs rentrent d’URSS.
Les victimes juives de l’antisémitisme polonais étaient déjà nombreuses depuis 1944. Des Juifs rescapés des camps ou cachés dans la forêt, qui reviennent dans leurs villages, sont accueillis aux cris de: «Quoi, ils ne sont pas tous morts?» Des incidents antisémites sont signalés. Des Juifs retournés dans leurs villages disparaissent. D’autres sont retrouvés morts sur les routes ou dans les bois. Ces faits passent d’abord inaperçus. L’insécurité est un problème pour tous, et même les soldats russes tombent victimes des nationalistes. L’ Allemand parti, le Russe est devenu l’ennemi, comme l’est également le communiste polonais. Dans une église, un curé avait prévenu: «Attention, les Russes et les Juifs reviennent. Bientôt ils seront ici. Alors vengez-vous des Russes et des Juifs avant qu’il ne soit trop tard. » Le gouvernement provisoire publie en juillet 1944, à Chelm, déjà libérée, un manifeste assurant les Juifs de droits égaux. Lublin devient la capitale provisoire du nouveau gouvernement, en juillet 1944 également. Dans tout l’Est libéré (Lublin, Chelm, Zamosc), les règlements de compte se poursuivent avec les forces nationalistes («les gars dans la forêt», les organisations NSZ, NZW1…).
Un Comité central des Juifs de Pologne est créé à la veille de l’offensive d’hiver de l’Armée rouge. Il regroupe des sionistes, des socialistes, des communistes. Il tient sa première assemblée nationale en novembre 1944 à Lublin, et organise l’accueil des survivants. En janvier 1945, Varsovie, Lodz, Cracovie puis Katowice sont libérés.
Les attaques contre les Juifs dans les villages éloignés, dans les trains et les autobus sont souvent le fait d’unités nationalistes, qui n’ont pas capitulé après la dissolution de l’AK (Armée de l’intérieur)2 en janvier 1945, et qui combattent les «ennemis de la Pologne». Mais les paysans tuent aussi pour ne pas avoir à rendre les maisons qu’ils avaient volées, ou par crainte d’être inquiétés pour les dénonciations qu’ils avaient commises. En mai 1945 est promulguée une loi qui abroge tous les contrats de propriété passés entre des tiers et les autorités d’occupation, et qui prévoit que toute propriété abandonnée du fait de la guerre sera rendue.
Au-delà des meurtres individuels, le premier pogrom a lieu à Cracovie en août 1945: attaques de synagogues, de centres communautaires et d’appartements, assassinats. Dans toute la région, qui accueille des Juifs d’autres lieux, les exactions se multiplient. Elles s’étendent à toute la Pologne. C’est dans ce contexte que le bruit court au début de 1946 que des dizaines de milliers de Juifs vont rentrer d’URSS. Ces retours s’opèrent à partir du printemps 1946, sur ordre de Staline, contre l’avis de Gomulka, vice-premier ministre polonais. La décision est prise de diriger ces Juifs vers les provinces de l’Ouest, récupérées ou prises sur l’Allemagne en 1945, en particulier vers la Silésie et la Poméranie. Ces régions sont peu peuplées car désertées par les Allemands, qui ont pris la fuite ou bien en ont été chassés par les Polonais. Aux yeux du gouvernement polonais, cela a un autre avantage: les Juifs ne reviendront ainsi pas dans leurs villages d’origine. En juillet 1946, ils sont 150000 à être revenus. La Communauté juive en Pologne a quadruplé, et atteint 200000 à 250000 personnes. En dehors des régions de l’Ouest, beaucoup s’installent à Lodz, moins détruite que d’autres villes comme Varsovie, et où un grand centre de rapatriement fonctionne: à Lodz se trouvent 17000 rescapés des camps, 1500 anciens partisans, 2000 rescapés des forêts et du ghetto, et 10000 réfugiés d’URSS.
Les assassinats dans les trains se répandent. En mai 1946, alors que les rapatriements s’accélèrent, le Comité central de Varsovie a établi une liste de près d’un millier de morts officiellement recensés.
Le journaliste
Léon Leneman raconte:
« J’ai fait moi aussi partie des premières vagues de rapatriés
d’Union soviétique. Nous étions heureux de rentrer et n’imaginions
pas un seul instant que les Polonais étaient restés antisémites
après tout ce qui venait de se passer sous leurs yeux. Il a vite
fallu abandonner nos espoirs. J’ai vu des trains arrêtés en rase
campagne puis attaqués par les bandes de la NSZ. Ils volaient les
bagages, battaient et tuaient les Juifs qui étaient descendus des
wagons après que les Polonais eurent crié: "Officiers soviétiques
et Juifs, sortez, quittez le train". Il faut rappeler que ces
fascistes polonais résistaient contre la présence de l’armée
soviétique et la prise de pouvoir par les staliniens locaux rentrés
de Moscou. L’animosité envers les Russes était très forte à ce
moment-là. Les Juifs étaient fusillés sur place. Les Russes on les
emmenait ailleurs. Pour en faire quoi? Nous ne l’avons jamais su,
mais je ne pense pas qu’il y ait eu des représailles de la part de
l’Armée rouge, du moins pas à ma connaissance.
La première réaction de ceux qui, comme moi, avaient échappé aux
attaques de trains, ces massacres de la liberté, consistait à
retourner dans leur ville ou dans leur village à la recherche des
membres de la famille dont ils avaient été séparés. Ils ne
retrouvaient personne. Tous avaient été exterminés.
Alors commençait la quête pour un détail, un renseignement, un
souvenir. Un nouveau drame se greffait sur le premier: ici ou là,
les gens retrouvaient leurs meubles, un objet ayant appartenu aux
parents, une voiture d’enfant… chez le voisin d’à côté ou d’en face.
La tragédie prenait alors des proportions inhumaines pour ces
rescapés, qui se rendaient peu à peu compte que les familles avaient
été exterminées avec l’aide de ces nouveaux ‘propriétaires’ de biens
juifs, les voisins polonais. »
Un autre
témoignage du retour en Pologne précise:
« Quiconque a fait partie de ces convois vous dira que, même de
nuit, les yeux fermés, il pouvait reconnaître, à la seconde près,
l’instant où le train était entré en territoire polonais. Lorsqu’il
ne s’agissait pas d’une attaque en règle, avec exécution de quelques
gens pris au hasard pour nous faire passer l’envie de rester en
Pologne, les pierres lancées contre nos wagons nous servaient de
message d’avertissement. Le jour nous étendions des couvertures aux
fenêtres afin de nous dissimuler au regard des paysans et aussi de
nous protéger des jets de pierres. Nos convoyeurs, venus de Varsovie
afin d’organiser les départs, pour nous mettre en garde, nous
avaient parlé des assassinats et des attaques de trains. Nous ne
voulions pas les croire. Des meurtres de Juifs après l’holocauste,
cela nous semblait inimaginable. Au bout de quelques heures de
voyage, nous étions fixés. Rien n’avait changé dans ce pays. Ce qui
explique qu’un certain nombre de rapatriés ne sont descendus du
train qui venait de l’Est que pour monter dans un autre, en partance
pour l’Ouest celui-là.
Nous allions trouver sur place quelques milliers de survivants des
camps. Ils nous racontèrent que les Polonais ne voulaient plus d’eux
et qu’ils avaient déjà tué plusieurs centaines de Juifs avant notre
arrivée. Leur peur aurait fini par être contagieuse si nous n’avions
pas été dirigés à l’autre bout de la Pologne, là où l’antisémitisme
–faute de Juif – n’avait pas encore fait de victimes. »
Dans les territoires de l’Ouest de la Pologne, où se réfugient nombre de ceux qui rentrent d'URSS, se reconstitue une activité économique et renaît une vie juive, culturelle et religieuse. Dans les écoles, on apprend le yiddish, l’hébreu et le polonais. A Szczecin, un habitant sur deux est juif en mai 1946, et le yiddish devient prédominant dans les rues et sur les enseignes des boutiques. A Wroclaw, un théâtre se crée. En Basse - Silésie, les témoignages font état d’un grand calme. Yaakov Lustig, dans un entretien avec Marc Hillel raconte: «Celui qui venait de l’extérieur était surpris. Le plus extraordinaire est que les Juifs vivaient dans la plus parfaite tranquillité, comparé à ce qui se passait dans le reste de la Pologne. Certes les journaux les tenaient au courant des meurtres perpétrés par les terroristes. Ils se sentaient concernés, mais pas directement. Quand nous leur expliquions que nous nous barricadions, la nuit, par crainte d’une attaque, c’est tout juste s’ils acceptaient de nous croire. Pour eux, l’occupation était terminée et la confiance qu’ils mettaient dans un gouvernement socialiste les poussait à envisager l’avenir des Juifs en Pologne avec sérénité. D’ailleurs ils adhéraient nombreux au parti et entretenaient avec la population locale d’excellentes relations. Le miracle tenait au fait que Juifs et Chrétiens étaient logés à la même enseigne, c’est-à-dire qu’ils se partageaient un butin pris aux Allemands. Les Polonais, transplantés eux aussi, n’avaient donc aucune raison de massacrer les Juifs. »
À la différence de la Basse - Silésie et de la Poméranie au Nord (territoires allemands auparavant), la situation de la Haute - Silésie, au Sud, est plus tendue. La réinstallation des Juifs est rendue plus délicate du fait de la présence d’une forte population autochtone polonaise: dans ce territoire devenu polonais à partir de 1922, une politique de polonisation avait été menée. En 1945, des dizaines de milliers de Polonais silésiens, transplantés vers l’Est par les Allemands en 1939, emboîtent le pas de l’Armée rouge afin de rentrer chez eux, tandis que les Volksdeutsche (population allemande) sont chassés. Des Polonais d’autres régions arrivent aussi en masse. Ainsi, moins chanceux que ceux de Basse - Silésie ou de Poméranie qui ne rencontrent que des Polonais transplantés comme ils le sont eux-mêmes, les Juifs de Haute - Silésie, redevenue polonaise, sont contraints de se greffer sur une majorité de Silésiens autochtones.
Mais contrairement aux districts de Kielce, Lublin, Lodz et Cracovie, les populations environnantes donnent aux survivants juifs l’impression qu’ils sont, sinon acceptés, du moins tolérés. Les Polonais de Haute - Silésie, très marqués par des siècles d’influence germanique, n’avaient pas fait preuve d’un patriotisme marqué pendant la guerre; la résistance fut peu active et l’aide aux Juifs encore plus faible que partout ailleurs (l’extermination des Juifs, nombreux dans cette région, fut immédiate en 1939 dès l’invasion allemande). Ils ne tenaient donc pas à aggraver leur cas face au nouveau régime, et les Juifs se sont sentis plus libres de leurs mouvements. Ces régions sont plus calmes qu’ailleurs, et servent de vitrine pour les journalistes étrangers; les incidents restent isolés. Dans un premier temps seulement.
Le 3 juin à Katowice, un train en provenance d’URSS est attaqué à la gare. Un mort, beaucoup de blessés. Mais la police intervient rapidement.
«Après
cet affreux drame de la gare, d’où je suis sortie indemne, nos gens
en Silésie ont commencé à partager la peur des autres. Dans la
journée, ils étaient des Polonais qui participaient à la
reconstruction de leur pays, la nuit ils redevenaient des Juifs qui
se barricadaient à l’intérieur des maisons à plusieurs familles dans
une pièce et sous la protection de quelques hommes armés. Mais nous
avions très peur malgré tout. Certaines familles pliaient bagage et
s’en allaient vers la frontière.
L’hostilité n’a cessé d’augmenter, à cause de l’arrivée des
rapatriés d’URSS, qui se poursuivait, et de l’oppression policière
qui s’abattait sur les Polonais, la police en profitant pour
poursuivre les anti-communistes. La participation de Juifs à ces
actions était vécue comme insupportable par les Polonais. »
À l’Ouest, le médecin responsable de l’organisation de santé et d’entraide juive OSE est assassiné chez lui. Une jeune fille de 20 ans est tuée dans le kibboutz créé à Zabrze, à 20 kilomètres de Katowice. Dans le reste de la Pologne, les agressions se développent, y compris contre des orphelinats qui regroupent les enfants rescapés.
Les départs vers la Palestine ou vers les pays occidentaux via les camps de DP (personnes déplacées) d’Allemagne et d’Autriche s’accélèrent.
Le 4 juillet 1946 a lieu le pogrom de Kielce, une petite ville située au Sud de Varsovie. Un enfant polonais avait disparu. Les Juifs sont accusés de l’avoir enfermé dans une cave, sur fond de meurtre rituel. La maison communautaire est attaquée. 42 personnes, près du tiers de la communauté des survivants, sont tuées. 20000 Polonais y ont participé.
D’autres assassinats ont encore lieu, après ce pogrom, dans les trains qui viennent d’URSS. Des incidents surviennent partout. « À Klodzko, en Basse -Silésie, une femme parvient à répandre rapidement une rumeur inhabituelle, donc plus efficace: "Une jeune fille polonaise a été violée par un Juif". Heureusement, la police veille. Mais aux policiers venus l’arrêter, elle déclare: "J’espérais pouvoir, à moi seule, déclencher un autre Kielce." »
Environ 1500 Juifs ont été tués après la fin de la guerre. 100000 Juifs ont quitté la Pologne dans les trois mois qui ont suivi le pogrom de Kielce. Il est resté 100000 à 120000 Juifs en Pologne.
Sources :
Le Massacre des survivants en Pologne, 1945-1947, Marc
Hillel, Plon, 1985, dont sont extraites les citations ci-dessus.
Pour une analyse de l’antisémitisme en Pologne après la guerre,
voir: Fear, Anti-semitism in Poland after Auschwitz, an Essay
in historical Interpretation, Jan T. Gross, Random House, 2006.
L’auteur analyse la violence anti-juive d’après-guerre dans le
contexte de la crise de la société après la guerre, mais aussi et
surtout dans le contexte des comportements des Polonais pendant la
guerre et des relations polono - juives avant la guerre.
Voir aussi: Les Voisins. 10 juillet 1941. Un massacre de Juifs
en Pologne, Jan T. Gross, Fayard, 2002. L’auteur raconte le
pogrom de Jedwabne, perpétré par des Polonais en 1941. Il explique
comment ce sont des Polonais ordinaires, et pas seulement une
poignée de salauds, qui massacrèrent. Les Juifs conduits dans la
grange qui allait être incendiée virent des visages familiers, des
voisins. Jan Gross dit: «Il existait une dynamique autonome des
relations entre Juifs et Polonais dans le cadre des contraintes
imposées par les occupants. Il est des choses que les gens auraient
pu faire à l’époque et dont ils se sont abstenus; il en est qu’ils
n’étaient pas tenus de faire et qu’ils ont néanmoins faites.» Dans
ce village après la guerre, des Polonais ont été menacés et frappés
pour avoir secouru des Juifs; certains ont demandé à rester dans
l’anonymat, au lieu d’être reconnus comme Justes.
1. NSZ: Narodowe Sily Zbrojne, Forces armées nationales; NZW: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Association militaire nationale. Certains groupes de combat contre les Allemands se maintiennent après la guerre et combattent les «indésirables», désormais les communistes et les Juifs.
2. AK: Armia Krajowa. Actuellement, des historiens polonais commencent à faire et à publier des travaux sur le rôle de l’AK dans les assassinats de Juifs après la guerre.